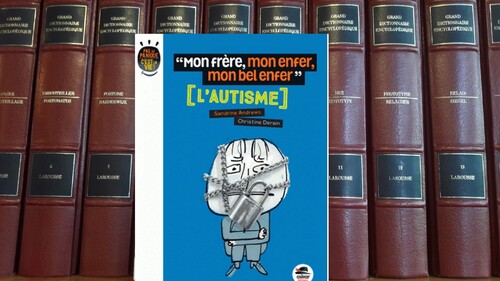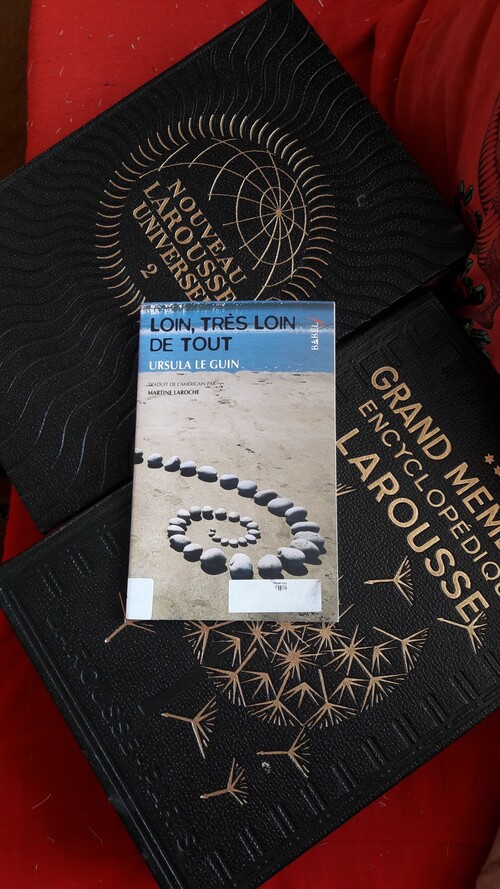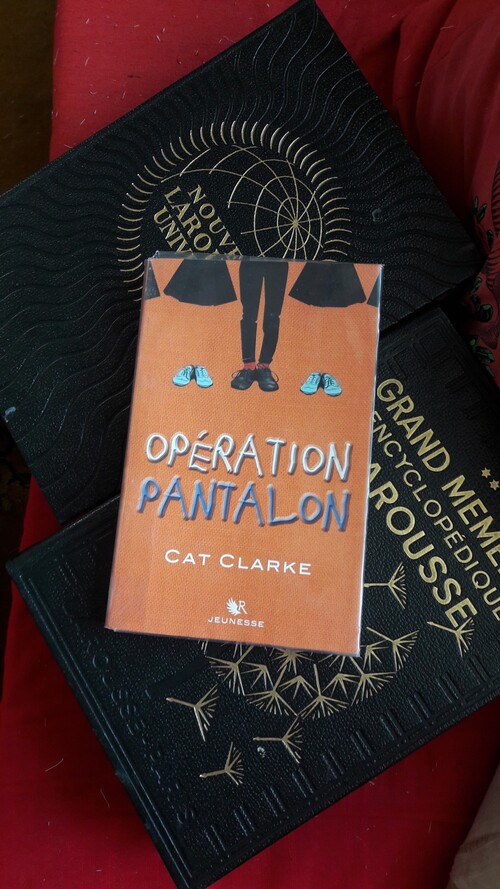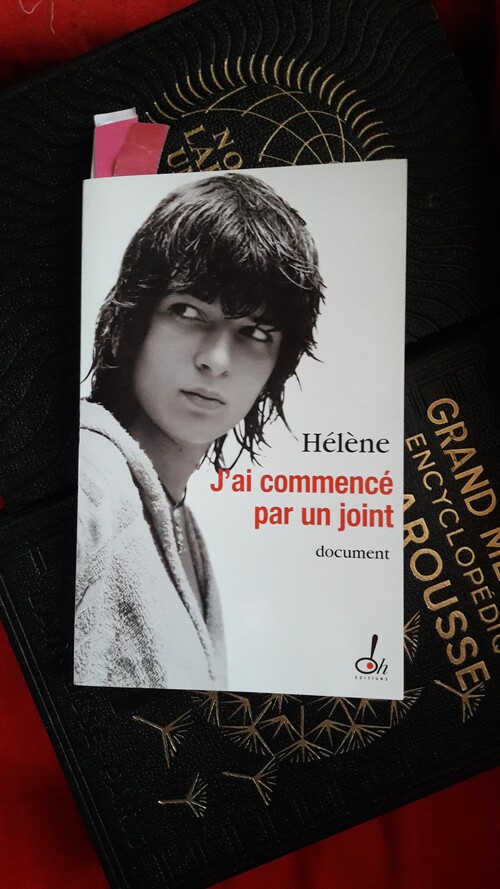-
Par La Célestine le 11 Octobre 2020 à 10:24
« Je n'aurai plus jamais faim, me suis-je dit. Il était sept heures du soir et j'avais faim.
(…)
J'avais treize ans, et fini de grandir. On mange pour grandir. je ne grandirai plus, m'étais-je dit. Je ne mangerai plus que le minimum. Ce qu'il faut pour durer. Cela faisait comme un champ d'exploration immense, la découverte d'un territoire sauvage et secret. » (p.9)
« Je ne dis pas à Joëlle mes raisons. Je ne ferai pas de psychanalyse, parce que j'ai peur de ce qu'il y a dans ma tête, comme les autres filles de ma classe. Et aussi, parce que j'y tiens, c'est mon capital le plus précieux, comme dit mon grand-oncle, qui est communiste. » (p.14)
« C'était une nouvelle certitude (...) : je risquais de devenir folle, et le pire, me disais-je avec effroi, c'était la peur non pas principalement d'être folle, mais d'être folle et par conséquent de ne pas me rendre compte que j'étais folle. Et c'était une inquiétude assez légitime, car j'étais en train de devenir folle, de ne pas m'en rendre compte du tout. » (p.20)
« D'où vient tout ce mal dont on l'accuse ? Elle sait juste qu'elle n'a la paix dans son coeur qu'à ce prix : que le bébé soit gavée, et qu'elle, Nouk, ressente, dans son ventre, les crampes vertigineuses de la faim. » (p.67)
« Nouk est si mal guérie, elle ne pense qu'à la manière de faire vite repartir toute cette mauvaise graisse qu'on l'a obligée à accepter, ce déguisement de survie. » (p.95)
« Ils m'ont dit deux choses dont je me souviens. La première, c'est que, contrairement à ce que je pense, ce n'est pas très important, la beauté.
Que j'avais tort de penser trop à cela, être belle, ou être laide. Ils ont dit que j'étais bien assez belle pour ne pas me torturer avec ce faux problème. Je n'en ai pas cru un mot, mais certaines phrases s'impriment pour toujours et celle-ci en fait partie. C'était comme s'ils me disaient de moins me fatiguer. » (p.96)
(Petite de Geneviève BRISAC)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 17 Juillet 2020 à 20:11
« Pourtant tu étais si mignon quand tu es né, j'étais si contente quand je suis venue te voir à la maternité, avec ta petite tête toute rouge, on aurait dit la pomme de Blanche-Neige. Mais pourquoi tu n'as pas grandi comme les autres ? Pourquoi tu ne nous as pas regardés quand on te parlait ? Pourquoi tu n'as pas pris ma main quand je te l'ai tendue ? » (p.5-6)
« - Quand est-ce qu’on va arrêter de faire semblant de savoir comment l’aider ? Y a rien pour lui… C’est le no Adam’s land, personne ne cherche à le comprendre. Enfin presque personne. Parce que heureusement qu’il a son SESSAD… Eux au moins, ils sont aux petits soins, Adam adore les voir !
- Son quoi ? A demandé Hugo.
- Le SESSAD, ça veut dire service d’éducation spéciale et de soins à domicile, les éducatrices sont des spécialistes de l’autisme, elles sont super chouettes et quand elles viennent à la maison ou à l’école, tout de suite l’ambiance change…
Si tu voyais le sourire de mon frère et puis celui de la mère… Et Adam, il s’y éclate, il a même commencé à s’y faire des copains… Eh oui, c’est pas parce qu’il a l’air débile qu’il est débile, il est intelligent mais c’est pas sa faute si son corps, ses sens ne font pas ce qu’il veut… Imagine-toi dix secondes dans une salle archi bruyante et plein de lumières partout qui font mal aux yeux, tu craquerais. Eh ben lui c’est tout le temps comme ça dans sa tête. Est-ce que tu crois que tu arriverais à avoir une conversation normale dans ces conditions ? Est-ce que tu crois que tu arriverais à savoir qui te parle ? Et à entendre clairement ce qu’on te dit ?
- T’énerve pas, je savais pas que c’était ça l’autisme. » (p.35-36)
« Mais imaginez : déjà nous qui sommes tous les jours avec lui et qui faisons notre maximum pour le comprendre, on a du mal à le décoder, des fois ; eh ben, quand il sera grand, s’il n’est pas capable de s’exprimer correctement, personne n’aura la patience d’attendre qu’il ait fini sa phrase ou qu’il la répète, on va tout le temps se moquer de lui, ou passer à autre chose. Et ça, ça me fait vraiment peur…
Parce qu’en fait, je ne le dis pas souvent mais je l’aime, Dark Vador, enfin, c’est Anakin que je cherche en lui, je voudrais tellement le trouver… C’est dur de voir que son frère n’est jamais vraiment là, qu’il est emprisonné dans une enveloppe, une sorte d’armure, parfois c’est comme un mur, vitré, parce qu’Adam me regarde mais il est tellement loin dans ses histoires, que je n’arrive pas à le rejoindre. Et puis, c’est bizarre mais certains jours, il est là, tu ne sais pas pourquoi, il est vraiment là et là pendant cinq minutes, tu peux vraiment lui parler et il te répond, là je sais que parle avec Anakin, pardon Adam, je sais que c’est lui mon vrai petit frère… Et puis la seconde d’après il est capturé, captif de ses dérèglements sensoriels, c’est comme s’il avait perdu les commandes de son cerveau ; je vois bien à ses yeux, il est loin, et je ne sais pas quand je pourrai le retrouver. Je sais qu’il est parti. Sans dire au revoir…
C’est horrible, alors j’ai envie de casser la vitre, de m’élancer contre elle et la briser ; ce serait tellement simple. Tant pis si je me fais mal, je voudrais tellement retrouver mon frère… C’est une sensation tellement horrible, personne ne peut comprendre ça… C’est un peu comme s’il était mort, sans être mort, parce qu’il est bien vivant, il s’agite, il parle comme s’il s’adressait à des compagnons invisibles, dans un espace sans nom... » (p.42-43)
« Alors là, je dois dire, je n’y avais jamais pensé que pour ce genre de personnes - « les handicapés dans la tête » - ce n’était pas facile. Je croyais qu’ils ne se rendaient pas compte. » (p.53)
« Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu’il rencontre quelqu’un de nouveau, il faut qu’il lui chipe un truc, comme si c’était sa façon de dire : « Salut, tu sais je peux pas parler, je peux pas te regarder dans les yeux mais on peut être en contact si tu me passes un truc à toi... »
C’est comme un symbole, un trait d’union. Normalement, on se serre la main, eh bien lui, il préfère serrer un truc qui appartient à l’autre, qui n’est pas l’autre, mais qui est un peu lui quand même... » (p.58)
(Mon frère, mon enfer, mon bel enfer de Christine DEROIN et Sandrine ANDREWS)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 9 Juillet 2020 à 20:27
« - C’est une vraie crise d’hystérie, gémit sa mère.
Du coup, son père se leva et allongea une taloche à sa fille, histoire de la calmer.
Pour l’hystérie, c’était peut-être salutaire. Mais je savais, moi, qu’il s’agissait de bien autre chose.
La révolte, la frustration de n’avoir pu exprimer son désespoir, ses angoisses, toutes les questions qu’elle s’était posées au sujet de la mort. Elle devait beaucoup souffrir.
Je trouvais étrange qu’un médecin puisse déceler une maladie mais demeure aveugle devant le mal de vivre de sa propre fille. » (p.19)
« - Larry, tu crois que je suis normale ?
- C’est quoi, être normale ?
- Être comme les autres.
- Ils sont comment les autres ?
- Ils rient, ils ont plein de copains, ils n’ont pas d’angoisses…
- Qu’est-ce qui t’angoisse à ce point ?
Elle hésita, plongea son visage dans ses mains comme si le monde entier pesait sur ses épaules.
- De ne pas savoir qui je suis.
- On se pose tous cette question, un jour ou l’autre.
- Mais non, pas tout le monde…
- Tu n’es pas tout le monde. Chacun de nous est unique.
- C’est bien ce qui me fiche la trouille !
- Pourquoi ?
- Parce que je suis mal avec moi ! » (p.55)
« Je ne m’étais jamais interrogé sur les raisons qui poussaient les gens à boire ou à se droguer. Jim était un joyeux luron, tout le contraire d’Adélaïde. Des petits joints circulaient au collège mais je n’y avais jamais touché. Un type de ma classe avait dû tâter de la dure, car il avait subi une cure de désintoxication. Ensuite, plus personne ne l’avait revu.
Mais quand il s’agit de quelqu’un qu’on aime, c’est différent. A qui en parler ? Un prof ? Lequel ?
Maman, je devinais sa réponse : « Je te l’avais dit, cette fille n’est pas normale… je vais en toucher deux mots à ses parents ! » » (p.79)
« - Larry, le fait de boire ne signifie pas que l’on soit alcoolique.
Je levai sur lui un regard étonné.
- On ne devient pas alcoolique, on l’est. L’alcoolisme est une maladie qui peut s’éveiller à n’importe quel âge de la vie, ou bien jamais. Tout dépend des circonstances, continua-t-il paisiblement.
- Une… maladie ?
- Il ne faut pas confondre gros buveur et alcoolique. Le gros buveur peut s’arrêter quand il veut. Tandis qu’un seul verre suffira à éveiller ce mal chez l’alcoolique. Il ne pourra plus s’arrêter, et il sera en manque.
Adélaïde était-elle alcoolique… ou buvait-elle seulement pour s’amuser ? Comme Jim ?
- On peut donc être alcoolique et ne pas le savoir ?
- Oui. Comme toutes les maladies en sommeil. Celle-ci peut s’éveiller tôt ou tard, à la suite d’un choc émotionnel, ou bien s’être laissé entraîner par des copains. On boit un premier verre pour se sentir mieux dans sa peau, puis c’est la descente aux enfers.
- C’est… c’est héréditaire ?
- Pas obligatoirement. L’alcoolisme est de nature physiologique et psychique. De nombreux facteurs sont déterminants. Par exemple, un manque de sucre dans l’organisme, un mal de vivre permanent. C’est une maladie complexe et difficile à diagnostiquer.
- ça se soigne ?
- Oui, à condition de le vouloir, de renoncer à l’alcool, et de suivre une thérapie pour apprendre à vivre avec soi-même.
- Et ensuite, on est guéri ?
- Pas exactement, Larry. Un organisme fragile demeure vulnérable. On cesse d’être esclave de l’alcool, on retrouve sa joie de vivre, mais au premier verre, on repique.
Le silence retomba.
- Parle-moi de ton cousin, reprit-il. A-t-il eu un coup dur ? Subi un choc émotionnel ?
- Oui, dis-je en pensant à Beauregard.
- Et il a trouvé refuge dans l’alcool. C’est ça ?
- Un peu...oui.
- Alors, il continuera de boire. l’alcool est un mauvais ami. Il soulage provisoirement les problèmes affectifs, le malaise… Ton cousin t’a dit qu’il buvait ?
- Non… je m’en suis aperçu, mais il s’en cache.
- C’est normal. Les alcooliques culpabilisent. Ils sont rusés, soupçonneux, ils craignent d’être jugés quand ils ont un verre à la main. C’est ce qui les différencie des gros buveurs qui boivent ouvertement et se fichent éperdument de ce que pense l’entourage en les voyant tituber.
J’étais troublé par toutes les idées reçues qui me trottaient dans la tête.
Brad Bennett me regardait attentivement.
- Tu vois, Larry, dit-il lentement, ce n’est pas une tare. Les alcooliques ne sont pas méprisables, mais infiniment malheureux. Ils sont secrets, solitaires, hypersensibles. Ils sont obligés de mentir pour cacher leur mal de vivre à leur entourage. Ils ne dorment plus et, à la longue, ils peuvent devenir violents, souffrir d’hallucinations et sombrer dans la folie. » (p.81-84)
« - Quelles sont les intentions de son père ?
- C’est un toubib, je suppose qu’il songe à une désintoxication.
- Depuis quand boit-elle ?
- Presque un an.
- Dans ce cas, une cure à l’hôpital la fera souffrir, mais ne réglera pas son problème. As-tu entendu parles des Alcooliques Anonymes ?
(…)
- Oui. Mais je vois mal Adélaïde s’inscrire dans ce club !
- Ce n’est pas un club, Larry. C’est une association bénévole qui aide à rester sobre.
(…) J’irai voir son père. Toi, essaie de convaincre Adélaïde de s’y rendre. Car vois-tu, si elle refuse de s’avouer malade, personne au monde ne pourra l’aider. » (p.104-105)
« Si le docteur Larive digérait difficilement le problème dont souffrait sa fille, Harriett s’obstinait à le minimiser. Ce qui relevait de l’exploit, car Adélaïde traversait toutes les phases qui découlent du sevrage. Tantôt dotée d’une incroyable énergie. Tantôt sombrant dans l’abattement total. Le tout assaisonné souvent d’une humeur massacrante.
Je faisais l’apprentissage des formules à éviter :
« Comment tu te sens ? Est-ce que tu dors assez ? Tu veux qu’on discute ? »
Elle explosait comme une grenade :
- Je suis en super forme ! Qu’est-ce que ça peut te faire que j’aie ou non bien dormi ! On ne roupille pas ensemble ! Tu vas bientôt me lâcher les baskets ?
Je les lui lâchais, mais une heure plus tard :
- Pourquoi tu fais cette tête, mon Larry ? » (p.133)
(L’enfer secret d’Adélaïde de Jackie LANDREAUX)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 14 Mai 2020 à 16:07
« Lorsqu’on découvre qu’on est seul, vraiment seul, je crois que le plus souvent on panique. On se jette dans la situation exactement opposée et on se mêle à un groupe : club, équipe, association. On commence à s’habiller exactement comme les autres. C’est un moyen de se rendre invisible. La façon de coudre ses pièces sur les trous des jeans devient d’une importance incroyable. Si elles ne sont pas cousues comme il faut, vous n’y êtes pas. Vous devez y être. Y être. Vous avez remarqué comme ces mots sont bizarres ? être où ? être avec eux. Avec les autres. Tous ensemble. C’est le nombre qui fait la force. Je, ça n’existe pas. Je suis un insigne de basket-ball, le boute-en-train de la classe, l’ami de mes amis. Je suis une excroissance de cuir noir sur une Honda. Je suis dans le coup. Je suis un jeune à la page. Vous ne pouvez pas me voir. Ce que vous voyez, c’est nous. Seulement nous. Ensemble, peinards.
Et si Nous Vous apercevons, vous là-bas, tout seul dans votre coin, ou bien la chance est avec vous et nous vous ignorerons, sinon il se pourrait bien que nous vous lancions des pierres. Car nous n’aimons pas ceux qui ont sur leurs jeans des pièces différentes des nôtres, et qui nous rappellent que chacun de nous est seul, qu’aucun d’entre nous n’est peinard. » (p.9-10)
« Je n’ai pas expliqué tout cela à Natalie ce soir-là, bien sûr, mais nous avons quand même parlé un peu du lycée, du conformisme et de la difficulté d’être différent. C’est comme si, me dit-elle, nous n’avions pas d’autre choix que de vouloir être ce que sont les autres ou bien ce que les autres veulent que nous soyons. Il faut se conformer ou obéir. » (p.40)
« Ce que [ma mère] voulait, c’était primo que je sois vivant, secundo que je sois normal. J’étais vivant et j’accomplissais à peu près tout ce qu’elle attendait de moi. Si mes efforts n’aboutissaient pas à faire de moi un type normal, ils réussiraient au moins à en produire une honnête imitation pendant une bonne cinquantaine d’années. » (p.76)
« Il était parfois plus facile de mentir que de dire la vérité. Si j’avais dit à Jason que je n’avais pas envie d’aller au cinéma, il aurait discuté pour essayer de me convaincre. Et si je disais que j’allais entendre un concert, mes parents, tout autant que Jason, trouveraient que c’était là une étrange façon de passer sa soirée. Et j’étais écoeuré, fatigué d’être toujours le seul à faire des choses étranges. » (p.81)
(Loin, très loin de tout d’Ursula LE GUIN)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 10 Mai 2020 à 16:30
« Le collège de Bankridge possédait un code vestimentaire très strict, contrairement à quasiment toutes les écoles que j'avais fréquentées jusque-là. (...)
Le problème, c'est que celui qui avait établi le règlement avait décidé (pour quelle raison, je l'ignore) que les filles devaient porter une jupe alors que les garçons avaient droit au pantalon.
C'était sexiste. Stupide.
(...)
"Les filles doivent porter une jupe noire, plissée, mi-longue."
(...)
Le souci, ce n'était pas le terme "jupe" mais la formulation. La jupe n'était pas vraiment un problème pour moi. Non, le problème, c'était le mot "filles".
Voilà le truc :
J'ai peut-être l'apparence d'une fille, mais à l'intérieur, je suis un garçon. » (p.14-15)
« On devrait être libres de porter les habits qui expriment qui nous sommes. »
« J’ai pris conscience que j’étais différent à l’âge de sept ou huit ans. Ce n’est pas comme si je m’étais réveillé un beau matin en m’exclamant : « Je suis un garçon ! » Non. Ça m’a comme qui dirait titillé pendant quelques temps avant que je puisse y prêter attention. Alors j’ai commencé à me dire que le terme « fille » ne me correspondait pas vraiment. C’était comme une chaussure trop petite – je me sentais étriqué dedans.
Au début, je n’y ai pas vraiment pensé. Ça ne me semblait pas important d’être une fille ou un garçon. (…)
Au départ, j’étais simplement nerveux quand les gens employaient les mots « filles », ou « sœur », ou bien quand on s’entêtait à m’appeler Olivia, alors que j’insistais pour qu’on me surnomme Liv. (…) Peu à peu, j’ai commencé à ressentir de la colère et du chagrin sans aucune raison. La plupart des gens se fâcheraient si on les appelait en permanence quelque chose qu’ils ne sont pas. » (p.16-17)
« Durant l'été, j'avais passé beaucoup de temps sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur Google [...].
Le mot, je le connaissais déjà. 'Transgenre'. Et dans un sens, il me plaisait car il me faisait penser aux Transformers, et Enzo et moi, on adorait cette série de films. 'Trans' en est la version abrégée ; le terme est moins cool mais il est plus rapide à taper. J'ai ainsi découvert que la communauté trans était nombreuse. Un site, en particulier, répertoriait toutes leurs histoires personnelles. Je les avais lues et relues. Puis j'avais trouvé d'autres sites et blogs consacrés au sujet, ainsi que des tas de vidéos sur YouTube. C'était un immense soulagement. Je n'étais pas seul. » (p.25-26)
« A mon réveil, ma première pensée fut : « Maisie avait raison. Peut-être que je devrais essayer d’être un peu plus comme tout le monde. »
Ma seconde pensée contredit la première : « Non. Peut-être que je devrais essayer d’être un peu plus moi. » » (p.96)
« Au fond de moi, j'avais envie que quelqu'un le sache. Je voulais qu'au moins une personne me voie comme j'étais vraiment, au lieu de me voir comme on pensait que j'étais. Je voulais que quelqu'un voie le véritable moi. » (p.140)
« - Tu sais ce que 'transgenre' veut dire ?
[...]
- C'est quand un homme se déguise en femme ? Comme ce mec à la télé ?
[...]
- Non, ça ne veut pas dire ça. C'est plutôt quand une personne a le sentiment que son apparence ne reflète pas la manière dont elle se sent à l'intérieur. Enfin, c'est comme ça pour certains, mais c'est différent pour chaque personne... Bref, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est possible que tu regardes quelqu'un et que tu voies un garçon, mais à l'intérieur, ce garçon sait qu'il est en fait une fille. Ou bien... [...] Ou bien il se peut que tu regardes quelqu'un et que tu voies une fille, alors que ce n'est pas vraiment qui elle est.
(…)
- Je pense… je sais… que je suis transgenre. » (p.156-157)
« J'ai contemplé mon reflet. Il n'avait pas l'air heureux. Pour la première fois depuis des mois, je me suis vraiment regardé. Je me suis regardé à fond. QU'EST-CE QUI FAIT QU'ILS ME DÉTESTENT AUTANT ?
Mutant. Monstre. Il/Elle.
J'essayai de me mettre à leur place. Si je me voyais marcher dans la rue, qu'est-ce que je penserais ?
Je n'y arrivais pas. Je me voyais seulement MOI. Liv Spark. Une personne un peu gauche, mal à l'aise dans sa peau.
Je n'étais peut-être pas ravi de mon apparence - et surtout des transformations que subissait mon corps [de douze ans] mais je n'étais pas un monstre.
JE NE SUIS QU'UNE PERSONNE COMME LES AUTRES. OÙ EST LE MAL ? » (p.168)
« En vrai, on n'en a pas rien à faire. Bien sûr que ça nous atteint. Et ça fait mal d'entendre les gens dire ces choses sur vous. Mais avec le temps, la douleur se transforme. Au début, ça brûle et ça transperce, comme si on vous planter un poignard en plein cœur. Et puis à force d'entendre les mêmes insultes encore et encore, la douleur se mue en une sorte de souffrance sourde et palpitante - comme une rage de dent. Une douleur en arrière-plan qu’on arrive à ignorer plusieurs minutes d’affilée, sauf quand on est allongé dans son lit la nuit, et qu’on ne parvient pas à trouver le sommeil. C’est là que ça fait vraiment mal. » (p.152)
(Opération pantalon de Cat CLARKE)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 17 Avril 2020 à 16:02
« Ce que je comprends par-dessus tout, c'est la conviction d'être invisible alors que la tour se voit à des kilomètres à la ronde et qu'on ne peut pas la rater.
Le secteur dans lequel a été édifiée la tour Grenfell ressemble à tous ces quartiers que je connais comme ma poche : ces zones dites « défavorisées » où on nourrit une méfiance pathologique à l'égard des autorités et des personnes extérieures à la communauté, où les habitants sont convaincus qu'il ne sert à rien de participer au processus démocratique car ceux qui détiennent le pouvoir se contrefoutent des préoccupations de la « classe populaire ». » (p.16)
« Lorsqu'on est menacé de toutes parts, difficile de s'exprimer, sinon par l'agressivité. Le ressenti est bridé, soit par les moqueries, soit par l'intimidation. Ainsi, grandir au sein d'un quartier défavorisé, ou considéré comme tel, c'est grandir asphyxié. L'individualité suffoque, les moyens d'exprimer sa singularité aussi. Ce qui explique pourquoi tout le monde ou presque parle et s'habille de la même manière. Choisir l'anticonformisme, c'est se dessiner une cible dans le dos.
Gare à celui qui se démarque parce qu'il a plus de deux poches à son jean – culottée ! - ou plus de dix mots à son vocabulaire. » (p.49)
« En dépit des zones arborées, des terrains de football et des aires de loisirs, la qualité du logement n'est pas la même de part et d'autre du fleuve : l'une des deux rives est beaucoup plus délabrée. Pas parce qu'on y loge une population plus modeste, contrairement à ce que l'on pourrait penser ; votre adresse ne dépend que du hasard, c'est la loterie quand la municipalité attribue les logements. Sans cesse on construit de nouvelles maisons, sans cesse on réhabilite les plus anciennes et on « revitalise » des zones entières.
La plupart des habitants de Pollok, moi y compris, avaient beau être locataires dans le parc social, cela ne les empêchait pas de vivre comme si l'argent poussait sur les arbres. J'imagine que la honte qui rongeait pas mal de gens – et l'irrésistible envie de camoufler leur dénuement – expliquait la popularité jamais démentie du Pollok Centre. Là-bas, on pouvait se procurer la panoplie nécessaire pour donner le change : baskets neuves, joggings, chaînes, bagues, maillots de foot et crampons. Des articles et des accessoires aussi recherchés coûtaient un bras mais avoir l'air pauvre coûtait toujours beaucoup plus cher. » (p.60)
(Fauchés. Vivre et mourir pauvre de Darren McGARVEY)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 10 Avril 2020 à 15:43
"Connaissez-vous ce phénomène d’un visage qui vous devient familier ? Vous souvient-il de la première impression qu’il suscitait ? Les figures de cet ouvrage, comment les regarderez-vous ? Pour nous ils ont un visage. Peut-être votre vue est-elle plus large que la nôtre : vous leur imaginez énigme et univers… peut-être est-ce notre vue qui réduit ces linéaments à une image toute familière…
Peut-être la familiarité empatine-t-elle le mystère qui reste en chaque être.
Les êtres s’apprivoisent les uns les autres et ce faisant leur propre part sauvage, qui en partie leur restera. » (p.57)
(Une légère différence d’Eric GOUWY)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 6 Avril 2020 à 11:29
« Livio tenait son cap, il changea le verbe "pénaliser" en "criminaliser", ce qui voulait dire précisa-t-il, que l’État allemand pouvait condamner à des peines de prison ce que la loi nommait des "actes indécents entre hommes" et priver les homosexuels de leurs droits civiques, et ce jusqu'en 1994. » (p.27)
« Livio était déjà ailleurs, il pensait à cette chose incroyable que Hirschfeld avait accomplie, en collaborant avec le responsable de la police de Berlin pour que fût créé un "laissez-passer de travesti" à l'usage des personnes qui souhaitaient s'habiller avec les vêtements du sexe opposé sans qu'elles soient inquiétées. » (p.52)
« Et là, Livio a ajouté qu'il fallait se détendre, que ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire, il n'avait parlé que des homos et des handicapés, s'enfonçant davantage, il se plaçait du point de vue des nazis et pas de son propre point de vue. Il fallait prendre un peu de recul, s'entendit-il improviser, parce que si on faisait un rapide sondage dans la classe, on serait surpris de voir qu'à part les juifs, les Arabes, les Noirs, les fils d'immigrés en tous genres, les pédés, les éclopés, les tagueurs et autres poètes dégénérés, il ne restait pas grand monde. » (p.76)
(Jour de courage de Brigitte GIRAUD)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 30 Mars 2020 à 15:44
« Évoquer une « légère différence » revient à poser la question : « Qui es-tu, toi que Je regarde ? ». Toi que Je regarde avec un T et un J majuscule. Car il s’agit d’un regard, ce qui met nécessairement en jeu deux personnes : celui qui se laisse envahir par l’image de l’autre et cet autre qui accepte de montrer une facette de lui.
Toi qui ouvres ce livre, ta compréhension de la réalité de ces hommes et de ces femmes, que l’on dit différents, à peine dévoilée par le photographe, dépend autant de ce que tu as toi-même vécu, que du portrait qui t’est montré. C’est de toi autant que d’eux qu’il est question.
Par le truchement de l’image, tu es face à l’autre ; au-dedans de toi, une rencontre a lieu que peut-être tu n’oublieras pas car une part de toi aura été générée par cette rencontre ; elle te transforme.
« Qui es-tu ? » Tu es celui qui accepte de devenir lui-même grâce aux autres. »
(Une légère différence d’Eric GOUWY, p.5
– préface d’Albert JACQUARD)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 28 Mars 2020 à 08:38
« L’adolescence. A ce moment où l’on devrait pouvoir épanouir la somme des apprentissages de son enfance, en supposant qu’ils soient corrects, ce moment où l’on devrait pouvoir se découvrir soi-même – une plante qui a poussé et fleuri -, où l’on devrait pouvoir se montrer et dire : « Je ne suis pas une orchidée, une fleur de nénuphar, une pâquerette ou un pissenlit, je ne suis rien de ce que vous voudriez que je sois. Vous me vouliez jaune, je suis rouge ! Vous me vouliez en rose rouge de Baccarat ou en marguerite des champs ? Je n’avais pas le choix ? », on me lançait : « Tu as plutôt intérêt à être une orchidée… sinon, tu finiras coquelicot ! »
Et alors ? Si j’ai envie d’être un coquelicot ou une fleur de tiaré !
Et si les mathématiques m’emmerdent ? Passer « mon bac d’abord » ?
Est-ce une garantie d’être heureuse ? Et si l’obligation de remplir toutes les cases qui vous conviennent me donne envie de mourir d’avance ? » (p.17)
« Je voulais devenir une sorte de coquelicot ou mieux encore une fleur de tiaré dans un monde de cactus. Il me voulait cactus comme lui. J’aurais aimé qu’il me dise : « Tu seras coquelicot, ma fille, puisque tu en rêves. » (p.212)
(J’ai commencé par un joint par HELENE)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"