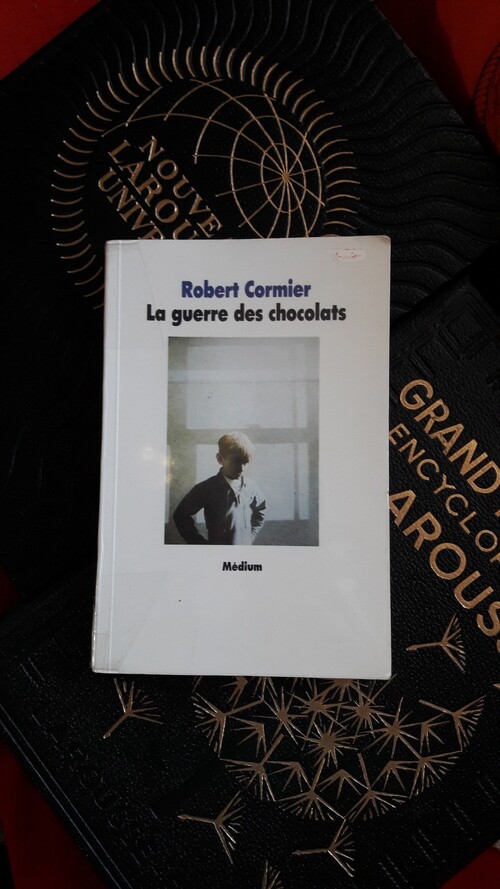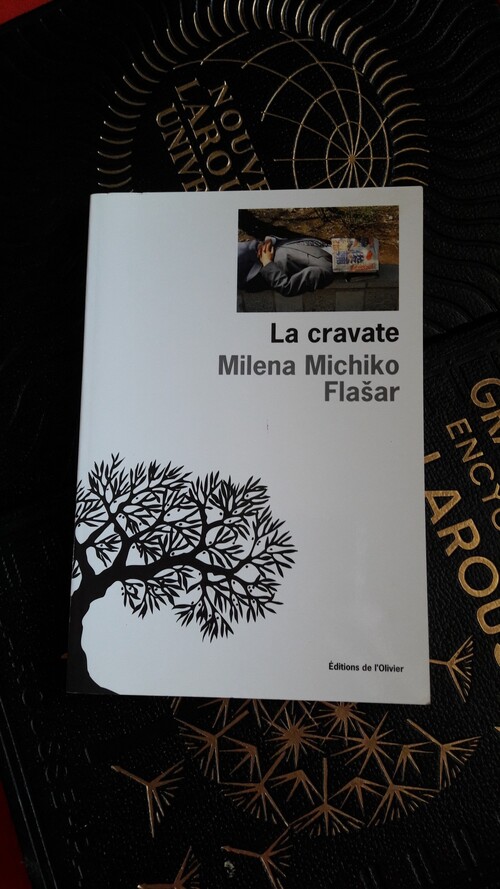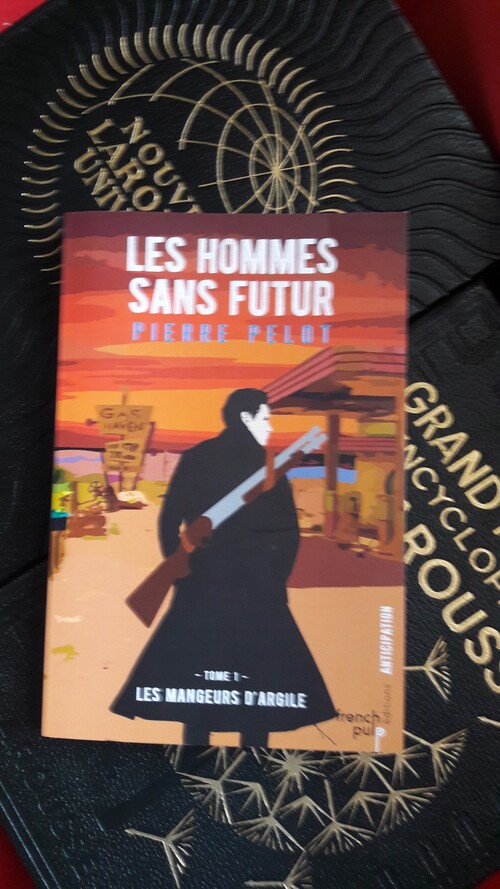-
Par La Célestine le 12 Mars 2020 à 09:24
« Au bout d'un moment, je pense que j'en ai eu un peu marre de me rabaisser sans arrêt, de détailler les autres et de me dire qu'elles étaient mieux que moi. J'ai senti que cette manie commençait à gêner mon entourage.
(…)
J'ai compris que si je n'apprenais pas à m'aimer, je ne pourrais pas aimer et être aimée.
Alors en arrivant à la fac, j'ai commencé à moins me maquiller, à mettre des vêtements qui me correspondaient vraiment, à réécouter de la musique que j'appréciais, qu'elle soit à la mode ou pas.
Je suis convaincue que nous sommes nombreux dans ce cas-là, à ne pas cultiver nos petites différences par peur d'être rejetés, et c'est dommage.
Quand tu te réconcilies avec elles, tu te retrouves TOI et ça fait tellement de bien ! »
Cher corps de Léa BORDIER
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 2 Juillet 2019 à 15:55
«La danse quotidienne des normes et des stéréotypes nous rappelle à quel point le corps est politique. Tout comme nos ébats amoureux. Le couple hétérosexuel monogame, blanc, beau et à l’éternel sourire de dentifrice, reste dans l’inconscient collectif le schéma souverain de l’état amoureux. Où sont les autres réalités ? Où est la mienne ?
Courtes-pattes, grassouillets, colorés, androgynes, trans, scarifiés, malades, handicapés, vieux, poilus, hors-critère-esthétique... Pédés, gouines, travelos, freaks, inconstants, cœur d'artichaut, multi-amoureux et aventuriers, nous écrivons nos propres poèmes, vibrons à travers nos propres romances. Nous ne sommes pas une minorité, nous sommes les alternatives. Car il y a autant de relations amoureuses qu'il y a d'imaginaires.
Ce recueil est un échantillonnage de notre palette. Si mon crayon n'arrive pas à retranscrire le goût des larmes, du silence férocement bruyant d'un coeur qui éclate, ni de tout l'épiderme qui se soulève dans une bouffée d'extase, que ce livre soit au moins un hommage rendu aux êtres amoureux qui vont à contre-courant de ce qui est attendu d'eux, parfois au péril de leur vie. »
(Préface de Julie MAROH à son livre Corps sonores)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 14 Janvier 2019 à 11:48
« Je n’ai pas écrit comment, après mon retour à Paris et le séjour de Lucile à Sainte-Anne, le temps d’une année scolaire, j’avais cessé de m’alimenter, jusqu’à sentir la mort dans mon corps. C’est d’ailleurs précisément ce que je voulais : sentir la mort dans mon corps. A dix-neuf ans, alors que je pesais trente-six kilos pour un mètre soixante-quinze, j’ai été admise à l’hôpital dans un état de dénutrition proche du coma.
En 2001, j’ai publié un roman qui raconte l’hospitalisation d’une jeune femme anorexique. Le froid qui l’envahit, la renutrition par sonde entérale, la rencontre avec d’autres patients, le retour progressif des sensations, des sentiments, la guérison. Jours sans faim est un roman en partie autobiographique.
(…)
L’anorexie ne se résume pas à la volonté qu’ont certaines jeunes filles de ressembler aux mannequins, de plus en plus maigres il est vrai, qui envahissent les pages des magazines féminins. Le jeûne est une drogue puissante et peu onéreuse, on oublie souvent de le dire. L’état de dénutrition anesthésie la douleur, les émotions, les sentiments, et fonctionne, dans un premier temps, comme une protection. L’anorexie restrictive est une addiction qui fait croire au contrôle alors qu’elle conduit le corps à sa destruction. J’ai eu la chance de rencontrer un médecin qui avait pris conscience de ça, à une époque où la plupart des anorexiques étaient enfermées entre quatre murs dans une pièce vide, avec pour seul horizon un contrat de poids.
(…)
Le docteur A. m’a posé quelques questions que j’ai oubliées, j’étais tendue, sur la défensive, je n’avais pas envie de parler avec cet homme, de pactiser avec lui de quelque manière que ce fût, je voulais lui montrer combien je désapprouvais son existence, à quel point je n’étais pas dupe. De quoi était-il capable, à part prescrire quelques gouttes supplémentaires à diluer dans des verres d’eau ? Soudain le docteur A. m’a demandé de m’asseoir sur les genoux de Lucile. Pour gagner du temps je l’ai fait répéter, j’ai pensé pour qui se prend-il ce connard, je portais un jean taille douze ans dont je revois la couleur, j’avais le souffle coupé, il a répété doucement : je voudrais que vous vous asseyiez sur les genoux de votre maman. Alors je me suis levée, je me suis assise sur les genoux de Lucile et, en moins de dix secondes, je me suis effondrée. Il y avait des mois que je n’avais pas pleuré, protégée que j’étais par le froid, la température basse de mon sang, endurcie par l’isolement, je commençais à devenir sourde à cause de la dénutrition, et au cours d’une même journée un nombre très limité d’informations parvenait à mon cerveau. » (p.303-306)
(Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de VIGAN)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 4 Janvier 2019 à 11:33
"Il regardait distraitement les gens de l'autre côté de la rue, sur le terrain communal. Il les voyait tous les jours. Ils faisaient maintenant partie du décor, comme le canon de la guerre civile, les monuments de la guerre mondiale, et la hampe du drapeau. Des hippies. Des enfants fleurs. Des gens de la rue. Des vagabonds. Des marginaux. Tout le monde avait un nom différent à leur donner. Ils apparaissaient au printemps et restaient jusqu'en octobre, ne faisant rien, interpelant parfois les passants, mais la plupart du temps vivant tranquilles, languissants et paisibles. Ils le fascinaient et il enviait parfois leurs vieux vêtements, leur laisser-aller, la façon dont ils semblaient se moquer de tout.
(...)
Absorbé dans ses pensées, il ne remarqua pas que l'une de ces personnes s'était détachée des autres et traversait la rue, en évitant adroitement les voitures.
"Eh, vieux !"
Stupéfait, Jerry se rendit compte que le type lui parlait.
"Moi ?"
Le gars était dans la rue, derrière une Volkswagen verte, la poitrine appuyée contre le toit de la voiture. "Oui, toi." Il avait environ dix-neuf ans, des cheveux longs et noirs lui tombant sur les épaules, une moustache ondulée, comme un serpent noir et flasque étendu sur la lèvre supérieure, les extrémités retombant sur le menton. "T'as les yeux braqués sur nous, vieux. Comme tous les jours, t'es là à nous regarder."
Ils disent vraiment vieux, pensa Jerry. Il ne pensait pas qu'on disait encore vieux, sauf en plaisantant. Mais ce type ne plaisantait pas.
"Eh, vieux, tu crois que nous sommes dans un zoo ? C'est pour ça que tu nous reluques ?"
"Non. Ecoutez, je ne vous regarde pas." Mais pourtant si, tous les jours, il les regardait.
"Si, vieux. Tu te mets là et tu nous regardes. Avec tes livres de classe et ta belle chemise et ta cravate blanc et bleu."
Jerry regarda autour de lui, mal à l'aise. Il ne vit que des étrangers, personne de l'école.
"Nous ne sommes pas sous-développés, vieux."
"Je n'ai pas dit ça."
"Mais on le dirait." (p.20-21)
(La guerre des chocolats de Robert CORMIER)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 24 Décembre 2018 à 10:35
« J’étais très proche de mon père. Maman m’a donné le nom de Wilma d’après Wilma Rudolph, une sorte de reine du sprint des années 1960. Elle a juste eu le temps de me voir apprendre à marcher, puis courir, comme le font les enfants, avant de partir travailler dans la région d’Uppsala où elle s’est fait écraser par un bus. (…)
Papa m’a tout de suite rebaptisée Wilmer et m’a élevée comme le fils qu’il n’a jamais eu. Ça a très bien fonctionné. Ce n’est qu’en commençant l’école, quand les autres garçons ne voulaient pas de moi dans leur bande, que j’ai compris qu’il y avait une erreur quelque part. Mais comme papa m’avait déjà appris à tirer à la carabine et que j’avais un petit renard apprivoisé, les garçons ont vite changé d’avis.
Les filles m’appelaient le Renard, à cause de la couleur de mes cheveux. Je m’entendais assez bien avec elles aussi, vraiment. Elles aimaient bien mon renard. Je pense que j’étais une enfant assez heureuse, mais durant l’adolescence, ça s’est corsé. Avec qui devais-je aller aux boums ? Mes meilleurs copains étaient des garçons, mais les filles savaient tant de choses que papa ne m’avait jamais apprises, des connaissances indispensables avant une boum. Elles savaient tout sur les suçons et les mouchoirs dans le soutien-gorge et comment utiliser le mascara. Fond de teint correcteur et gloss. (…)
Puis je suis tombée amoureuse de mon meilleur copain, Jonas. Je n’ai pas compris ce qui m’arrivait et lui non plus. Je voulais être avec lui tout le temps et au début, il n’avait rien contre. Jusqu’à ce que j’essaie de l’embrasser un jour chez lui, ça m’a pris comme ça. Il a paniqué en me voyant là, devant lui, en train de tourner la tête dans tous les sens pour dévier le nez d’une façon adaptée à la situation. Il s’est précipité dans la cuisine préparer un chocolat instantané, puis il m’a dit qu’il valait mieux que je parte parce que son frère allait rentrer. (…) Alors je suis rentrée et rien ne fut plus jamais pareil entre nous. Notre amitié était devenue inconfortable et la dernière année au lycée, on se saluait à peine.
J’avais du mal à comprendre. Pourquoi était-ce si difficile pour moi de trouver quelqu’un, alors que ça paraissait si facile pour les autres ? Je savais que je n’étais pas belle comme les nanas dans Vecko-Revyn, et que mon menton n’était pas terrible, mais beaucoup de mes copains étaient plus laids que moi, et ils avaient plus de boutons. Ils se trouvaient des copines quand même, ou alors c’était juste ce qu’ils disaient pour frimer.
Je ne pouvais pas en parler avec papa, il faisait hum et se raclait la gorge et il se fâchait presque contre moi quand le féminin prenait le dessus, comme quand j’ai eu mes premières règles. J’ai fait toute ma scolarité sans que personne ne m’ait jamais embrassée, mais j’étais admise aussi bien dans les bandes des garçons que dans celles des filles. Je les récompensais en étant joyeuse et en plaisantant tout le temps, je supportais tout, surveillais les sacs des filles et faisais le guet quand les garçons chapardaient. Je me sentais utile, ils avaient besoin de moi. » (p.124-126)
(Ma vie de pingouin de Katarina MAZETTI)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 20 Décembre 2018 à 10:30
« Je ne suis pas un hikikomori typique, repris-je. Pas un de ceux dont on parle dans les livres et les articles de journaux que l’on dépose de temps en temps sur le seuil de ma porte pour que je les lise. Je ne lis pas de mangas, je ne passe pas mes journées devant la télévision, ni la nuit devant l’ordinateur. Je ne construis pas de maquettes d’avions. Les jeux vidéos me donnent la nausée. Rien ne doit me distraire de la tentative de me préserver de moi-même. De mon nom par exemple, de mon héritage. Je suis fils unique. De mon corps, dont les besoins n’ont pas cessé, pour me maintenir. De ma faim, de ma soif. Au cours des deux années où j’ai décroché, mon corps était plus fort que moi trois fois par jour. Alors j’allais furtivement jusqu’à la porte, je l’entrouvrais et je soulevais le plateau que maman avait déposé. Quand il n’y avait personne à la maison, je me faufilais dans la salle de bains. Je me lavais. Etrange, ce besoin de me laver. Je me brossais les dents, je me peignais les cheveux. Ils étaient devenus longs. Un coup d’œil dans le miroir : j’existe encore. Je réprimais le cri coincé dans ma gorge. De lui aussi, je devais me préserver. De ma voix, de mon langage. Le langage dans lequel je note à présent que je ne sais pas si le hikikomori existe seulement. De même qu’il existe des chambres très différentes, il existe des hikikomoris très différents, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes pour les raisons les plus diverses et de la manière la plus variée. » (p.53-54)
« Les premiers temps, je ne suis sorti que lorsque j’étais certain que nul ne me dérangerait dans mon existence. Mon existence consistait à ne pas être là. J’étais le coussin sur lequel nul ne s’asseyait, la place qui restait vide à table, la prune entamée sur l’assiette que j’avais redéposée devant la porte. » (p.56)
« Je pris conscience du fait que papa et maman avaient été, eux aussi, des hikikomoris. Eux aussi avaient été enfermés avec moi dans la maison, puisque ma vie était liée à la leur. Pas de promenades à la mer. Pas de week-ends à O., la terre natale de ma mère. Un cinéma de temps en temps, ça oui. Être assis dans le noir. De temps en temps au restaurant. Avec des amis que l’on n’avait pas vus depuis une éternité. De temps en temps pour quelques heures en voiture. Partir, tout simplement, et imaginer comment ce serait de continuer la route. Jusqu’au bout du monde. Puis s’arrêter et se dire : Il y a quelqu’un qui a besoin de nous. Faire demi-tour. Et rentrer. Régulièrement, à quelques jours d’intervalle, aller chez les Fujimoto et faire ses courses. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Maman n’a jamais laissé passer aucun des repas. Parfois il y avait un tee-shirt avec. Des chaussettes. L’hiver, un pull-over. Beaucoup de lettres que je n’avais pas lues, que j’avais laissées devant la porte sans les avoir ouvertes. Je me demandais à présent de quoi elles avaient bien pu parler. Peut-être du fait que cela les avait rendus heureux de constater qu’il manquait un coca-cola dans le réfrigérateur ou que le carrelage de la salle de bains était mouillé. Mais peut-être aussi du fait que cela les avait rendus très tristes. Peut-être du fait qu’il leur était difficile de comprendre ce qui m’avait conduit à me fermer à eux. » (p.163)
(La cravate de Milena Michiko FLASAR)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 18 Décembre 2018 à 10:27
« Ils étaient des monstres, puisqu'ils étaient différents. » (p.9)
(Les hommes sans futur (Tome 1). Les mangeurs d’argile de Pierre PELOT)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 4 Décembre 2018 à 09:44
« La première fois que j’ai eu envie de me faire mal, j’avais douze ans. J’étais en sixième, dans un collège plutôt tranquille. Pas de problème de harcèlement, ni de racket, bi d’anorexie, ni de mauvaises notes, ni d’isolement. J’avais des copines, une passion pour la gym (qui m’a désertée depuis longtemps), des parents unis, aucune ombre au tableau.
Et pourtant. Justement.
Maman a toujours refusé de m’envoyer voir un psy. « Des charlatans » selon elle. Ma mère jugeait que mes « conduites automutilantes », selon le jargon qu’elle avait piqué sur Internet, n’étaient que le reflet de mon ennui, de mon désintérêt pour ma propre existence. Comme le symptôme du désœuvrement généralisé qui touchait notre génération. Moi, j’étais incapable de mettre des mots sur ça. Tout ce que je savais, c’est que de meurtrir ma chair m’apportait, aussi étrange que cela puisse paraître, du réconfort. Les premières fois, c’était avec la pointe de mon compas. Les mouchetures ténues qui parsemaient ma peau, les minuscules gouttes de sang qui y perlaient, je revois ça aussi clairement que si c’était hier. Je sens encore la caresse de la pulpe de mes doigts sur les cicatrices. Mais pas la douleur. C’est comme si elle n’avait été qu’un détail. Un ma ; nécessaire. Un artefact de l’expérience.
Puis, à mesure que le temps passait, les mouchetures sont devenues des écorchures. Les petites coupures, des estafilades. Les incisions, des entailles. Je vois encore la couleur du sang coagulant, je ressens encore sa tiédeur, sa texture poisseuse. La vie, quoi. Comme une preuve. Irréfutable. Que j’étais vivante. Que j’existais. Malgré tous mes doutes. Mes indécisions. Mes défauts. Tous ceux qu’on me mettait sous le nez en permanence, pensant que ça les guérirait.» (p.39-40)
(Des Bleus au Corps de Clara Richter)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 20 Novembre 2018 à 10:38
« - Les autres jeunes, les profs, ils ne m’aimaient pas. Je n’avais pas ma place parmi eux.
- Écoute. » Danny a laissé tomber ce qu’il était en train de faire pour venir se planter à côté de moi.
(…)
Ton apparence ne compte pas, ma chérie. Peut-être que ces enfants se comportent d’une certaine manière mais il faut que tu leur laisses une chance. Mon plus jeune fils, Ben, a le syndrome de Down. Pourtant, il va à l’école et il a une tonne de copains. Alors ne laisse pas tomber, OK ? »
J’ai senti les larmes gonfler mes paupières et j’ai penché la tête pour qu’il ne les voie pas. Si Danny avait été mon père, les choses auraient été différentes.
« Tu vois, a-t-il poursuivi, le monde est grand et cet endroit est tout petit. Une petite ville, de petits esprits. Mais toi, tu peux être plus grande que ça. D’accord ? » Il a tapoté mon épaule avec sa grosse paluche, très gentiment. Je lui ai adressé un sourire à travers mes larmes et j’ai essuyé mes yeux avec la manche de mon pull. » (p.143-144)
« « Tu es parfaite, mon coeur. Tu es différente mais ça ne t’empêche pas d’être parfaite. Tu ne peux rien changer à ton apparence, ce n’est pas ta faute. Tu entends ce que je te dis, Rebecca ? Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? »
Elle m’a dit que j’avais quelque chose, un syndrome. Je lui ai demandé si on pouvait l’attraper comme un rhume, par exemple, et si ça partait quand on grandissait.
Elle m’a répondu tristement : « Non. Non, mon coeur, je suis désolée. » Elle m’a dit que ça s’appelait Treacher Collins. Elle m’a expliqué que les os de mon visage ne s’étaient pas formés comme il le fallait quand j’étais dans le ventre de ma mère et que c’était la raison pour laquelle mon visage était un peu différent.
(…)
Même si elle m’avait expliqué ce qui n’allait pas, même si elle avait donné un nom à cette chose, même si elle m’avait dit que je n’étais pas la seule à devoir endurer cela, Les Parents avaient déjà décidé depuis longtemps de mon sort et je portais leur dégoût de moi comme une marque au fer rouge. » (p.206-207)
(Des bleus au coeur de Louisa REID)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 6 Novembre 2018 à 10:21
« Elle souffre d'anorexie mentale. Mentale, ça va avec le nom de la maladie, mais ça ne me plaît pas. Elle a la tête qu'il faut, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est très belle, très blonde, très douce, très têtue, très sensible. » (p.13)
« Manger. Le verbe a fini par me répugner. Le verbe, la fonction, ce transit grotesque entre deux extrémités. Il m’arrive, pour ce seul motif, d’admirer des grévistes de la faim. Je les crois purifiés d’une souillure. Des médecins me disent que, passé les premiers manques, les pénitentes trouvent un charme trouble à leur état. Quelques saints y ont même découvert le chemin d’une béatification. Le corps s’allège, l’esprit entre en lévitation. Bulle après bulle, le mal-être s’envole. Ne reste plus que le misérable sac d’os dont parlait Malraux. » (p.15)
(Lettres à l’absente de Patrick POIVRE D’ARVOR)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"