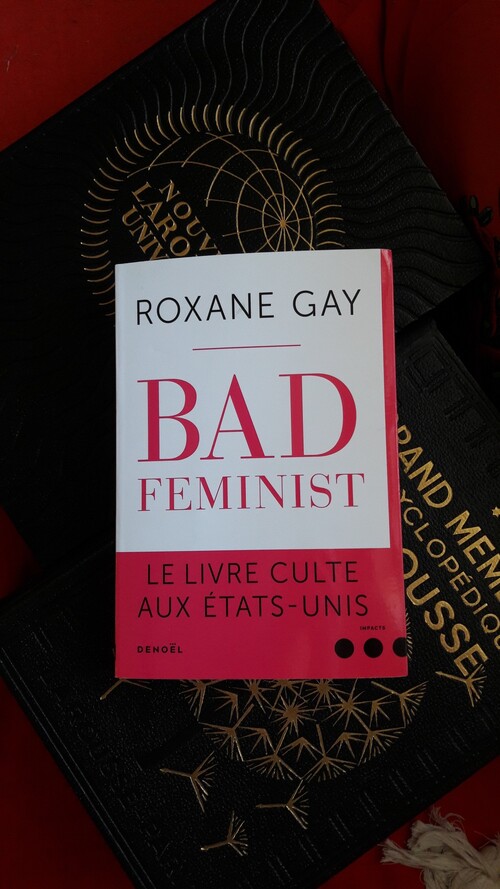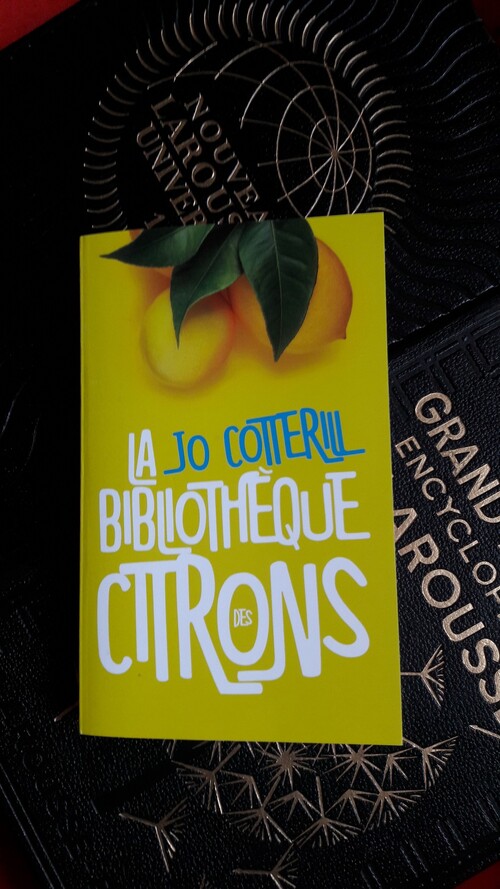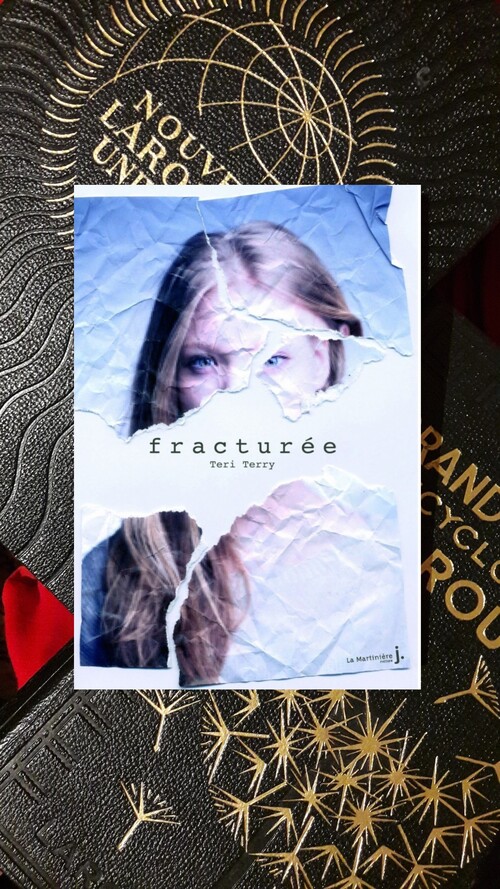-
Par La Célestine le 27 Octobre 2018 à 10:43
« Quelle générosité, dans cette recherche, sur la piste de ce que je pourrais être, quand les autres, généralement, se contentent de vous prendre par le bout qui les arrange. » (p.19)
« Je dis les fous. Par prudence. Dire, comme chacun s'autorise à le faire, les psychotiques, est une violence qui engendre des diagnostics, à vie. Par tendresse. On ne peut dire "les fous" sans les aimer un peu. Tous les pensionnaires ne méritent pas le mot. A côté des fous, il y a les fragiles, les boudeurs de la vie, les très fatigués. Si je m'autorise à les désigner, indifféremment, par le mot, c'est que les habitants de La Borde l'aiment bien. Nous, les fous.
Il ne les vexe pas : au contraire... » (p.28)
« Je crois que ce qu’on désigne du terme ingrat de « psychothérapie institutionnelle » a commencé par cet acte simple, de l’ordre du baptême : appeler les fous par leur nom. La façon dont il a prononcé son nom : Jacqueline. Tout commence là. Ensuite vient la phrase, qui déplie l’être chiffonné, lui redonnant, d’un air de gentille évidence, la syntaxe et la vie.
Alors, s’appuyant à chaque syllabe, l’être pourra, peut-être, réapprendre à marcher. » (p.37)
« Il a toujours pensé qu’il pouvait y avoir un dialogue entre des groupes d’êtres parlants et les délires les plus solitaires. Pas n’importe quels groupes, disait-il, ceux qui « laissent affleurer l’image la plus accomplie de la finitude humaine, toute entreprise mienne s’y trouvant dépossédée au nom d’une instance plus implacable que ma propre mort, celle de sa capture par l’existence d’autrui… » » (p.144-145)
(Dieu gît dans les détails de Marie DEPUSSé)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 23 Octobre 2018 à 09:55
" A bien des égards, être sympathique repose sur un mensonge très élaboré, une performance, un code de conduite qui nous dicte les bons comportements. Les personnages qui ne respectent pas ce code deviennent antipathique. Il ne faut pas forcément en vouloir à ceux qui pointent le caractère antipathique d’un personnage. Ils expriment un malaise dans la culture, un rejet plus général de tout ce qui est déplaisant, qui ose transgresser la norme du socialement acceptable. » (p.131)
« Quand une personne noire déroge à l’image idéale que la culture dominante a d’une personne noire, cela pose toutes sortes de problèmes. L’authenticité de sa négritude est immédiatement remise en question. Nous sommes censés être noirs mais pas trop noirs, ni trop vulgaires ni trop bourges. Il existe toutes sortes de règles non écrites sur ce qu’une personne noire devrait penser et faire, sur comment elle devrait se comporter, et ces règles changent tout le temps.
On demande à tout le monde d’obéir à des lois tacites qui régissent l’identité, le comportement, le mode de pensée et la parole. Nous prétendons détester les stéréotypes, mais nous avons un problème lorsque les gens s’en écartent. Un homme, ça ne pleure pas. Les féministes ne se rasent pas les jambes. Les habitants du sud des Etats-Unis sont racistes. Chacun, par sa simple humanité, enfreint une règle ou une autre, et bon sang, qu’est-ce qu’on déteste qu’une règle soit enfreinte ! » (p.369)
(Bad Feminist de Roxane GAY)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 3 Octobre 2018 à 11:00
« Victoire Morin schlinguait. Elle schlinguait même grave sa race le poisson pourri. Elle était atteinte du fish-odor syndrom. D’après ce qu’elle m’a expliqué un jour, c’est une histoire d’enzymes qui fonctionnent mal.
De mon côté, bien que j’aie plus d’une fois frôlé l’évanouissement, j’ai souvent béi secrètement le dieu des maladies de merde. Sans lui, Victoire n’aurait jamais été mon amie : en dehors de ses effluves corporels, elle avait tout pour devenir une pouffe parfaitement populaire et enviée. Car en plus d’être canon, elle était coquette à l’excès et incroyablement superficielle.
Malheureusement, parce qu’on la sentait venir à trois jours de marche, elle était reléguée au rang des parias. Comme moi. Elle se retrouva rapidement affublée du surnom de « Victoire Morue », ce qui me réjouissait, moi la Strud’balle de service. J’étais persuadée d’avoir trouvé mon âme sœur.
Comme toute personne appartenant à la caste des Intouchables, Victoire subissait une existence compliquée et pitoyable. Par exemple, elle devait suivre un régime alimentaire spécial pour ne pas puer encore plus, et échappait ainsi aux cours d’EPS. C’était un tel cas social qu’en comparaison, je passais pour une fille quasi fréquentable. » (p.19)
« - Le problème, très cher Pirach, c’est que tu vas officiellement quitter notre club !
- Jamais !
- De quel club vous parlez ?
J’oubliais : papa est toujours là, en train de vider son bol en nous regardant.
- Hein ? Ah oui… Hé bien, tu as devant toi la fondatrice et le président honoraire du club officiel des Minables.
- Quoi ?!
- Tu as bien entendu. Les Minables. On revendique notre capacité à être déplorables en toutes circonstances, ainsi que notre incroyable talent à nous maintenir éternellement en dessous de tout.
- Mais c’est vr…
- je sais : tu vas dire que c’est très relatif, la nullité, qu’on est tous le pouilleux de quelqu’un et que personne n’est foireux à 100 %. Mais crois-moi, le dernier sondage Ipsos qui nous concerne parle de lui-même. Enfin, tout ça, c’était avant la métamorphose ! J’ai bien l’impression que je vais devoir tenir nos fameuses réunions toute seule, dorénavant.
- Parce que vous n’êtes que deux ?
- Oui, on a essayé de recruter ceux qui nous semblaient à la hauteur de notre médiocrité, mais bizarrement, nos camarades sont assez chatouilleux sur ce sujet. Ça les vexe. Je crois que certains se savent pitoyables, mais préfèrent ne pas le vivre au grand jour. C’est parfois difficile d’assumer son moi profond. » (p.33)
« Vania, tu es insignifiante. Taille moyenne, élève moyenne… Fille moyenne. Pas parce que tu es née comme ça, mais parce que tu as choisi la transparence, la fadeur, l’insipidité.
(…)
Toute ta vie durant, tu as fait des non-choix. Sans ambition, ni volonté ou défi. Tu as subi les décisions de tes parents et tu continues de subir ton œil, de la même façon. Tu le caches derrière tes cheveux, tu baisses le nez, tu t’effaces… alors que c’est ce que tu as de plus beau ! Cocteau disait : « Ce qu’on te reproche, cultive-le : c’est toi. »
Ton œil gauche, c’est toi, Vania. A moitié fermée, planquée, honteuse.
(…)
Tu es grande, Vania. Alors, sors te tête de tes épaules et regarde droit devant toi.
Je sais que tu lis un tas de livres qui vantent la beauté de la discrétion, le charme de la banalité et la joie procurée par les petites choses. Mais figure-toi que tu as aussi le droit de devenir quelqu'un de remarquable. Tu as le droit d'être un individu à part entière plutôt qu'un vague point dans la masse.
Certes, nous sommes tous des fourmis, vus de la lune. Mais tu peux être la rouge parmi les noires. » (p.48-50)
(La Fourmi Rouge d’Emilie CHAZERAND)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 27 Septembre 2018 à 20:53
« Pas d’amant,
Pas d’enfant
J’suis la fille qui vit sans
La fille qui se suffit de sa vie.
Autrefois j’avais des ambitions
Un mec, un boulot, une maison
J’me suis fait une raison
J’me débrouille sans passion.
Pas d’argent
Pas de talent
J’suis la fille qui vit sans
La fille qui s’arrange
De ce qui dérange.
J’vis ma vie, sans entrain
Aujourd’hui ressemble à demain
Et demain ressemble à hier
Mes jours sont tous frères.
Pas d’amant
Pas d’enfant
J’suis la fille qui vit sans
La fille’ qui s’ennuie
Dans sa vie. » (p.52)
(Le journal d’Aurore. Rien ne va plus ! de Marie DESPLECHIN)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 25 Septembre 2018 à 20:50
« Récapitulons : je nais avec un ptosis, ce qui est déjà pas mal. On peut ajouter à ceci des genoux cagneux, des cheveux filasse ni bruns ni blonds (mais ça, il paraît que c’est très tendance : les Américains appellent cette nuance le « brond »).
Ensuite, je suis faite comme un mec, le léger détail du pénis mis à part. Les bons côtés ? Des hanches étroites et des mollets fins que même les travestis thaïlandais peuvent m’envier. Les mauvais ? Un cou de taureau et pas de seins.
Quoi d’autre…
Je joue de l’hélicon depuis mes neuf ans et j’adore ça. Je m’exerce tous les soirs, dans notre petite cave, pour ne gêner personne. Il faut être vraiment mélomane pour apprécier cet instrument… J’ai appris à jouer dans le noir, vu que la minuterie fait sauter la lumière toutes les quatre minutes.
Je fabrique des modèles réduits de scènes ordinaires, en papier canson blanc, dans des boîtes à chaussures vides. J’en ai vingt-trois à ce jour. C’est assez encombrant, mais chacune représente un moment important de ma vie et je ne peux, de fait, en jeter aucune : ce serait comme broyer un souvenir. Les versions miniatures de moi ont toujours l’air plus solides et heureuses que la vraie.
Je vénère Milan Kundera, dont je lirai et relirai probablement l’oeuvre complète jusqu’à ma mort. Je collectionne des trucs débiles comme les prospectus colorés que les marabouts sénégalais du quartier afro glissent parfois dans les boîtes aux lettres. Mon préféré reste celui qui promet le retour de l’être aimé en ces termes précis : « Il courra derrière vous comme un chien derrière son maître ».
Moi, les démonstrations d’affection en public me mettent mal à l’aise. J’ai globalement horreur de tout ce qui est embarrassant : les comédies musicales françaises, le stéthoscope du docteur sur la poitrine, se sourire à soi-même dans la cabine du photomaton, réciter un poème mièvre devant toute la classe, marcher sans serviette du banc jusqu’au bassin de la piscine, être serrée contre des corps inconnus dans le bus bondé, devoir enlever ses baskets dans le vestiaire après deux heures d’athlétisme, l’infirmière scolaire quand elle demande si on a mal au ventre parce qu’on a vraiment mal au ventre ou parce qu’on a un contrôle de géo et que tout ce qu’on connaît de la Grèce, c’est Nikos Aliagas et la feta.
Je ne supporte pas les mots « croûte », « flétan » et « conchier ». En revanche, j’éprouve un plaisir suspect à dire « plexus », « superfétatoire » ou encore « pyrolyse », et je m’efforce de les placer dès que je peux. J’ai peur des grains de beauté qui se transforment en cancer de la peau, alors je photographie les miens tous les mois pour observer leur évolution. Les gens qui ont des pellicules dans les sourcils me perturbent énormément mais, à l’inverse, j’adore ceux qui ont les oreilles asymétriques. J’aime les chaussures vernies, même si ça couine sur le lino, et les chemises d’homme – je porte d’ailleurs celles de papa presque tous les jours. Elles sont trop grandes, informes et je dois replier les manches au moins quatre fois, mais je m’y sens parfaitement à l’abri de tout ce qui m’angoisse : l’hostilité ambiante, le vent et la mode.
Ce portrait resterait incomplet sans la description de ma chambre qui est, selon mon père, à l’image de ma cervelle. Pleine à ras bord d’un joyeux bordel hétéroclite, composé d’une accumulation périlleuse de poignées de porte rouillées, gommes rigolotes, biographies de John Lennon et montres à gousset qu’on-pourrait-croire-très-anciennes-mais-obtenues-en-fait-grâce-à-un-vieil-abonnement-aux-éditions-Atlas.
Les rares pans de murs non occupés par des étagères déglinguées sont couverts d’affiches de Michael Sowa, un peintre allemand né en 1945. J’aime particulièrement celle de la volaille au collier de perles. Elle est très digne.
Tout cela réuni suffit à expliquer une certaine impopularité au lycée, je suppose, comme des Lego de bizarrerie emboîtés les uns dans les autres.
Papa dit que les choses évolueront un jour. Que les codes sociaux changent et que, si je reste immobile assez longtemps, je finirai bien par être tout à fait à la mode. Il croit fermement que dans vingt ans, toutes les ados dignes de ce nom pratiqueront des instruments à cuivre pesant douze kilos, garderont un œil constamment fermé pour avoir l’air désabusé et rêveront de s’appeler comme moi.
Parce que oui, la cerise sur le pompon, c'est mon prénom. Et mon nom. Vania Strudel. Strudel - qu'on doit prononcer "chtroudel", si on veut être parfaitement académique. Un blase de protège-slip accolé à une pâtisserie autrichienne bourrative. Youpi. La moitié de mes chers camarades m'appelle Tampax et le reste opte pour Strud'balle.
Adorable, n'est-ce pas ? » (p. 10-13)
« - Ma chérie, le monde est plein de lâches qui disent ce qu’on leur dit de dire, font ce qu’on leur dit de faire et pensent aussi mal qu’on leur dit de penser. Et il y a quelques courageux, des optimistes trop rares, qui osent réfléchir." (p.108)
« - T’es la plus belle personne de la terre, Vania Strudel. T’es drôle, t’es intelligente, t’es sensible et gentille. j’aime chacune de tes bizarreries. j’aime tous les machins en toi qui font que plein de gens ne t’aiment pas. j’aime que tu n’accordes aucune attention à tes habits ou ta coiffure… J’aime quand tu lis de trop près ou quand tu fronces les sourcils pour regarder un truc au loin. J’aime quand tu coupes tes aliments pour que tous les morceaux soient à peu près de la même taille, avant de commencer à manger. J’aime que tu utilises des mots vieillots, que tu milites contre les parcs à orques, que tu cuisines du pâtisson et d’autres légumes qu’on ferait mieux de vraiment oublier. J’aime quand tu me donnes le titre de la chanson que t’avais en tête à ton réveil, que je fais semblant de pas la connaître juste pour que tu me la chantes, très mal. J’aime le fait que t’arrêtes pas de glisser et de tomber, en hiver, et que tu t’enroules dans ton vieux cache-nez en laine. Le vert et rouge, avec les pompons blancs. J'aime que tu sois pleine d'impasses, de sens interdits, que t'aies des zones piétonnes en toi, où je ne peux pas me rendre avec mon bulldozer. J'aime ne pas tout connaître de toi et deviner que je vais aimer ce qui me reste à découvrir. J'aime être un personnage de tes scènes en papier, dans tes boîtes à chaussures. Mais j'aimerais encore plus qu'on les vive pour de vrai. Tous les deux. » (p.180)
(La Fourmi Rouge d’Emilie CHAZERAND)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 23 Septembre 2018 à 20:47
« Quand j’ai arrêté de picoler, je me suis dit : « Comment tu vas tenir le coup ? » Alors je me suis répondu que j’avais qu’à faire comme si j’étais sur une île déserte, pas un bistrot à l’horizon, pas un marchand de vin, rien, comme si j’étais Robinson Crusoé. T’as un canif et un bout de ficelle et démerde-toi avec pour construire un monde. Epave parmi les épaves, je n’avais que ça pour m’en tirer. C’est de cette façon que je suis devenu artiste. Bien sûr, on ne le sais pas tout de suite, et puis, qu’est-ce que ça veut dire ?... J’avais juste envie de m’évader. Faut être un peu malheureux, sans doute. Il n’y a que les prisonniers qui s’évadent.
- Alors ça se vend ?
- Ben oui, ça m’étonne autant que toi.
- Cher ?
- ça veut dire quoi, cher ? Je suis hors de prix, comme un beau coucher de soleil, comme un bon moment passé avec un ami. On n’achète pas le bonheur et c’est tant mieux ! Qu’est-ce qu’il leur resterait, aux pauvres ?... La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie.
Vincent ne comprend pas tout. Trop de mots, d’idées qui se bousculent dans sa tête comme des autos tamponneuses.
- Quand même, tout ce pognon et tu vis là, dans ce…
- Trou ?... comme une cloche ?... Ben oui, mais je suis chez moi et je m’y sens bien.
Vaut mieux mourir dans sa peau que vivre dans celle d’un autre. » (p.72-73)
(J’irai te voir de Pascal GARNIER)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 20 Août 2018 à 08:51
« En fait, je me suis roulé moi-même, et si Lina ne m’avait pas aidé, je serais mort roulé. Ses yeux s’embuèrent : Ce qu’elle a fait de plus beau pour moi, c’est de m’obliger à la clarté. Elle m’a appris à me dire : Quand j’effleure le pied nu de cette femme, je n’éprouve rien, alors que je meurs d’envie d’effleurer le pied de cet homme-là – oui, celui-là -, de lui caresser les mains, de lui couper les ongles avec de petits ciseaux, d’appuyer sur ses points noirs, d’être avec lui dans un dancing et de lui dire : Si tu sais valser, invite-moi et montre-moi comment tu guides !
Il évoqua des moments très anciens : Tu te souviens, quand Lina et toi vous êtes venues chez nous demander à mon père de vous rendre vos poupées ? Il m’a appelé et m’a demandé, pour se foutre de moi : Alfo, c’est toi qui les as prises ? parce que j’étais la honte de la famille, je jouais avec les poupées de ma sœur et mettais les colliers de maman… Il m’expliqua, mais comme si je savais déjà tout et n’étais là que pour lui permettre d’exprimer sa véritable nature : Déjà, quand j’étais petit, non seulement je savais que je n’étais pas ce que les autres croyaient, mais je n’étais pas non plus ce que je croyais être moi-même. Je me disais : je suis quelque chose d’autre, quelque chose qui est caché dans mes veines, qui n’a pas de nom et qui attend. Mais je ne savais pas ce que c’était, et surtout je ne savais pas comment ça pouvait être moi. Jusqu’à ce que Lila m’oblige – je ne sais pas comment l’exprimer autrement – à prendre un peu d’elle. Tu sais comment elle est ! Elle m’a dit : Commence par ça, et vois un peu ce qui se passe. Ainsi nous nous sommes mélangés, c’était très amusant, et maintenant je ne suis plus celui que j’étais mais je ne suis pas Lila non plus, je suis une autre personne, qui se précise peu à peu. » (p.239-240)
(L’enfant perdue. L’amie prodigieuse, tome 4 d’Elena FERRANTE)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 14 Août 2018 à 19:00
-Tu fais du latin à l'école ?
- Hmm. C'est ma matière préférée. A vous, je peux le dire. »
Valérie sourit intérieurement. Elle savait ce qu'il entendait par là. S'il avouait cela à ses camarades de classe, il passerait tout de suite pour le fayot de service et serait mis sur la touche. D'un autre côté, il avait plutôt l'air d'un solitaire. Les garçons de son âge ne traînaient pas des après-midi entiers dans une librairie à considérer des livres sous leur aspect esthétique. » (p.129)
(Une année particulière de Thomas MONTASSER)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 13 Juin 2018 à 16:57
« Papa dit toujours qu’il faut se considérer comme son propre meilleur ami. Quand j’étais plus petite, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais maintenant, je vois bien. Ça veut dire qu’on doit être heureux quand on est seul ; qu’on ne devrait pas avoir besoin de la compagnie des autres pour être heureux.
(…)
A l’école, les maîtresses s’inquiétaient souvent de me voir m’asseoir à l’écart des autres. Elles écrivaient des mots du genre : « C’est une fillette très solitaire » ou « Elle s’isole ». Comme s’il s’agissait d’une mauvaise attitude.
(…)
- Ils n’y connaissent rien, a dit papa (…). Ils ne comprennent pas les gens qui n’ont pas besoin d’être entourés. Ils croient que l’indépendance va de pair avec la solitude. Ils n’ont jamais entendu parler de la force intérieure.» (p.8-9)
« A l’école, les autres enfants n’essaient plus de m’avoir pour meilleure amie. J’aime bien jouer avec eux – ce n’est pas que je n’aime pas les gens. Mais pour être honnête, je préfère les livres. J’aime l’espace de calme qu’ils créent dans ma tête ; un espace où peuvent surgir des mondes magiques, des îles ou des mystères. » (p.11)
« Depuis que maman est morte, j’ai toujours eu l’impression de ne pas être normale. Comme si je ne rentrais pas dans les cases. Je préférais la lecture à l’amitié. Je vivais avec un père qui, la moitié du temps, ne semblait pas s’apercevoir de ma présence, qui n’aimait pas m’embrasser, et qui mettait l’accent sur la force intérieure. Ça ne me dérangeait pas exactement, mais je ne me sentais pas normale.
Et si la normalité n’existait pas vraiment ?
Si j’étais normale dans un monde où tout est normal et rien n’est normal ? L’idée n’est pas crédible. » (p.237)
« Mais il s’est trompé sur toute la ligne. Les gens ont besoin des gens. On ne peut pas passer sa vie à l’écart des autres pour éviter de souffrir. Le seul résultat, c’est qu’on souffre de toute façon ET qu’on est seul.
(…)
Papa n’est pas seul. Je suis là. Et maintenant je comprends où trouver ma force intérieure. On doit la recevoir des autres. Quand une personne est attentive à vous, elle vous donne un peu d’elle-même, ce qui vous fortifie. » (p.302-303)
« C’est alors qu’il commença à se transformer en monstre. Parce que, non content de verrouiller son propre coeur, il apprit à la petite fille à faire de même. Il lui apprit que les idées et les livres étaient plus importants que les gens et les sentiments, il la regarda avec fierté s’adapter à cette vie solitaire, sans jamais se rendre compte qu’elle se retrouvait seule elle aussi... » (p.330)
« Les gens réagissent souvent ainsi, ils disent ou font une chose pour cacher un sentiment très différent. Je faisais cela jusqu’à ma rencontre avec Mae. Maintenant, j’essaie d’être plus honnête envers moi-même, parce que si on est incapable d’être honnête envers soi-même, comment peut-on être honnête envers les autres ? » (p .358-359)
(La bibliothèque des citrons de Jo COTTERILL)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 1 Juin 2018 à 15:06
"Je chasse leurs formules de mon esprit. C'est à moi, et à moi seule, de réfléchir en cet instant. C'est à moi de décider, ici et maintenant. je ne suis plus celle que j'étais autrefois, celle que Nico voulait que je sois. je reste presque bouche bée devant l'idée qui se fait jour en moi : je serai uniquement ce que je déciderai d'être." (p.376)
"J'ai trop longtemps été manipulée, tiraillée entre ce que j'étais et ce que je suis devenue. mais qui veux-je être, au fond ?
Je l'ignore encore, mais ce que je suis et ce que je fais maintenant, c'est à moi et à moi seule d'en décider." (p.380)
(Fracturée de Teri TERRY)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"