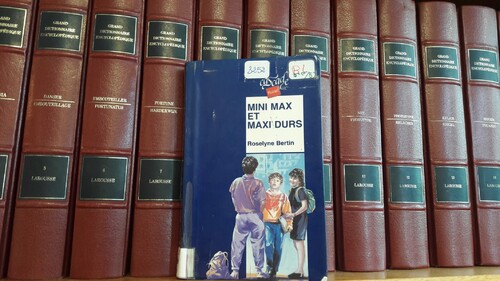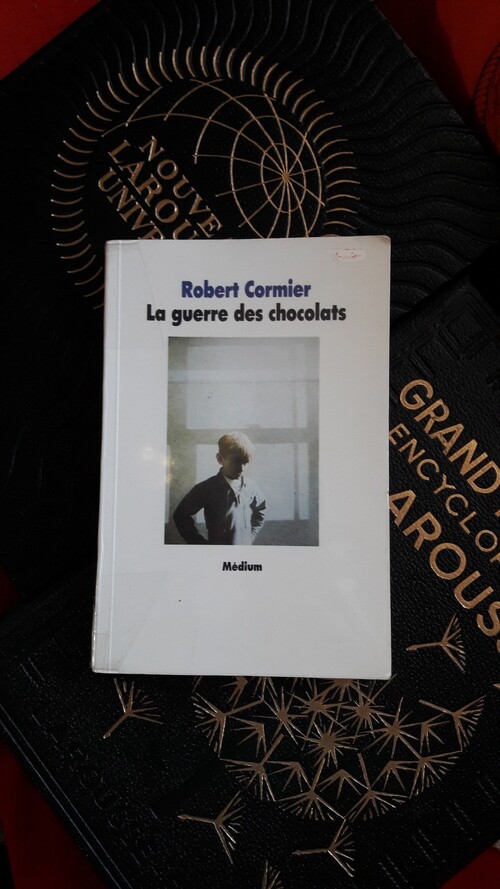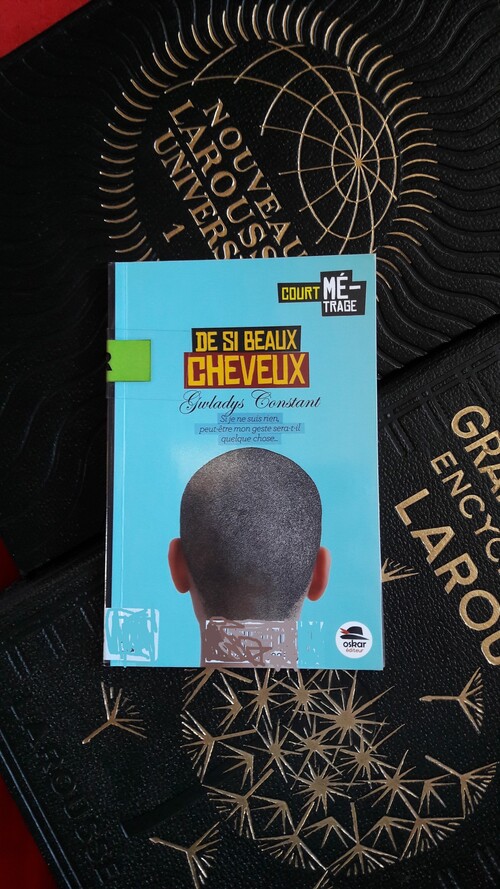-
Par La Célestine le 15 Juin 2020 à 20:00
« Allez, rase-bitume, tire-toi ! Les sixièmes, c’est là-bas !
(…)
- Eh ! T’as entendu ? Les p’tits nouveaux, c’est là-bas, sous le préau !
Je le sais bien qu’on les rassemble sous le préau, les futurs élèves de sixième, le principal l’a annoncé assez fort dans son mégaphone !
Comme il a annoncé que l’appel des classes de cinquième serait fait à la cantine et celui des classes de quatrième devant le garage à vélos. C’est donc vers là que je me suis dirigé, parce que c’est en classe de quatrième que j’entre, même si je ne mesure qu’un mètre trente-cinq. Et n’allez pas croire que je suis un surdoué qui fait sa scolarité avec trois ans d’avance. Non, j’ai treize ans, comme tout le monde. Mais je ne suis pas très grand pour mon âge, voilà tout ! Je suis même franchement petit. » (p.7-8)
« C’est une fille qui s’exclame :
- Oh dis donc, il est drôlement petit ! Il est encore plus petit que les sixièmes !
(…)
Elle n’a peut-être pas parlé méchamment mais, derrière moi, les autres s’en donnent à coeur joie.
- Pire que ma sœur qui est en CM2 !
- Eh, Thomas, tu es battu cette fois !
- Il est plus petit que Maÿlis !
- C’est un nain !
Voilà, le mot est lâché : nain ! Qu’est-ce que ça veut dire, nain, d’abord ? J’ai seulement un « retard de croissance dû à un problème d’hypophyse ». D’abord, je suis suivi et soigné, ensuite je suis « petit mais harmonieux ». (p.14)
« - Alors, le p’tit nain, lance Pédro, on se fait chouchouter par les filles, on appelle sa mère, on a peur des copains de la classe ?
- T’es mieux avec les gonzesses, hein, minus, c’est plus ton genre ? Dit l’un des deux petits malins.
- Ouais, c’est mademoiselle Maxime !
- Y se sont gourés tes parents, c’est pas Max qu’ils auraient dû t’appeler ! Comme maximum, t’es pas terrible, c’est plutôt du minimum chez toi ! reprend Pédro.
Et Gentilhomme, eh ! C’est pas terrible non plus ! C’est pas gentil que t’es, c’est petit, c’est Petithomme qu’on devrait t’appeler, dit le deuxième petit malin. » (p.32)
« - Eh, le nain, t’arrête de gigoter ?
Il en a de bonnes Pédro, ils sont tous là à me bourrer ! J’en ai marre, à la fin, qu’est-ce qu’ils veulent ? Que je prenne d’un coup trente centimètres, pour leur faire plaisir ? Je ne demande pas mieux, moi ! Du coup, j’éclate :
- Qu’est-ce que tu veux, Pédro ? Qu’est-ce que vous me voulez ? Je suis petit, bon, j’y peux rien ! Y en a qui sont gros, d’autres qui sont noirs, d’autres qui sont nés en Algérie, on n’y peut rien, c’est comme ça !
- Quoi Qu’est-ce que t’as contre les Arabes ? Lance un Maghrébin qui m’a attrapé par le col de ma chemise.
- Mais… lâche-moi ! J’ai rien contre eux ! Je dis qu’il y en a qui sont algériens et d’autres pas et voilà ! Et Pédro il est portugais, et alors ? C’est comme ça, on va pas lui taper dessus pour autant ! » (p.36-37)
« - Alors le nain ? On barbote ?
C’est Nathan qui vient d’arriver à vélo.
Nathan, quand nous sommes seuls, il m’appelle le nain, parfois, et c’est une façon de me dire qu’on est des potes. Un mot, c’est fou comme il peut changer de sens, suivant qui le dit et comment il le dit. » (p.90)
(Mini Max et maxi durs de Roselyne BERTIN)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 4 Mai 2020 à 16:41
« Il fallait constamment se tenir prêtes, parce que ça pouvait arriver n’importe quand. N’importe qui pouvait à n’importe quel moment faire un geste, un bruit, un pas dans notre direction.
Et ça arrivait tout le temps bien sûr. Que des garçons passent devant des filles et que l’un d’eux serre son poing devant sa braguette et lève le bras comme un pénis en érection tout en émettant des bruits dégueulasses. Qu’un autre se joigne à son petit jeu en pressant à plusieurs reprises sa langue contre l’intérieur de sa joue. Et, pour finir, comme d’un commun accord, qu’ils déversent sur les filles tout le répertoire de mots dégradants puisés dans les films pornos.
Il n’y avait qu’une manière efficace de répondre. Fermer la bouche, rester droite et garder le masque bien que chaque mot, chaque geste, chaque bruit s’immisce sous notre peau. Le plus souvent, on y parvenait. On se regardait dans le blanc des yeux, celle qui était en train de parler oubliait ce qu’elle disait mais ne s’interrompait pas pour autant. On l’encourageait avec des hochements de tête, en nous persuadant mutuellement en silence que tout allait bien, qu’il ne fallait pas s’occuper d’eux, pas se retourner, qu’il fallait continuer de parler, ne pas leur montrer qu’on avait peur, surtout ne pas leur montrer qu’on avait peur.
Mais il arrivait que le groupe de garçons décide d’aller plus loin. Qu’il s’approche de nous, nous encercle, nous fixe d’un regard inflexible. Nous savions alors que nous étions les élues. Ils se tenaient tellement près de nous que leur haleine formait un mur devant nos visages et qu’il était impossible de nous retourner. Ils sortaient leur langue, la passaient sur nos joues, cherchaient nos lèvres. Leurs mains de garçons nous tripotaient, remontaient le long de nos cuisses. Ils nous chuchotaient à l’oreille de fausses répliques d’amour avec des voies apprêtées et mielleuses.
Si on réussissait à rester de marbre, si on gardait les yeux rivés au sol pendant qu’ils nous touchaient avec leurs sales mains ou qu’ils nous léchaient avec leur sale langue, on finissait par recevoir un coup de poing dans les seins ou un gros mollard devant nos pieds. Avant de partir, ils nous sifflaient entre les dents qu’on était de vraies mochetés, qu’on était tellement répugnantes qu’aucun garçon ne voudrait jamais de nous, même si on le payait.
On n’ouvrait surtout pas la bouche. On comptait à l’envers dans nos têtes pour réussir à ne pas bouger et à attendre que ça se termine. Mais parfois on n’en pouvait plus. Alors Momo, Bella et moi, on se mettait à crier. On leur disait de nous laisser tranquilles. On se débattait, on leur crachait au visage, on leur donnait des coups de genoux. Mais ils étaient désespérément, injustement, incompréhensiblement plus forts que nous. Ils riaient, nous attrapaient les mains et se moquaient de nos petits poings serrés. Eux seuls avaient le droit de décider quand le jeu s’arrêterait.
Je ne supportais pas ça. Je les détestais. J’aurais pu accepter n’importe quoi, n’importe quelle humiliation pour ne pas avoir à subir ces signaux ambigus dirigés contre nous, contre les filles. Les répliques mielleuses, les mains qui malgré tout étaient chaudes contre nos corps, les sourires obliques qui malgré tout nous déstabilisaient. Et tout de suite après, le rejet, les crachats, le dégoût, les preuves de notre insignifiance. » (p.25-27)
(Trois garçons de Jessica SCHIEFAUER)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 26 Avril 2020 à 16:48
« Dès qu’elle bougeait, les seins de Bella ballotaient. Aucun tee-shirt au monde ne pouvait les rendre invisibles. Lorsqu’elle s’est finalement mise à courir, qu’elle a pris de la vitesse et qu’elle a vraiment essayé de s’investir – pour son équipe -, les garçons se sont tout de suite moqués en sifflant et en applaudissant.
Bella s’est arrêtée net. Ses joues étaient écarlates. Quelque part dans le chœur des voix de garçons, quelqu’un a crié :
- Approche-toi. Approche-toi que je les touche !
Ça m’a retourné le ventre. J’ai pensé au géant dans mes rêves. Je m’imaginais traverser le terrain, attraper les garçons avec mes énormes mains et les balancer le plus loin possible. Mais mon corps de fille était trop faible, trop maigre. J’ai baissé la tête et j’ai avalé plusieurs fois ma salive pour essayer de faire descendre la boule que j’avais dans la gorge.
Le prof se tenait devant nous avec son sifflet. Il avait vu la scène mais il n’a pas réagi. Il a sifflé et le jeu s’est arrêté. Le cours était terminé.
(…)
[Bella] se dirigeait vers le vestiaire, la tête baissée. Je l’ai rejointe et j’ai posé ma main sur son épaule. Elle s’est arrêtée et m’a fait un sourire pâle.
- Ils sont tellement puérils.
J’ai voulu lui sourire, essayer de la consoler, lui dire « Je sais, ils sont vraiment trop cons, t’occupe pas d’eux », mais je n’y arrivais pas parce que je savais que ce n’était pas une question de puérilité. Au contraire. Les garçons étaient déjà bien trop habitués à pouvoir faire ce qu’ils voulaient avec nous.
(…)
Arrivées à l’angle, on a vu qu’ils nous attendaient devant la porte.
Je me suis arrêtée, mais pas Bella. Comme si elle avait subitement décidé de ne plus se laisser faire, d’arrêter de subir. Elle a levé le menton, n’a pas croisé les bras mais les a laissé pendre le long de son corps. Elle a foncé droit sur eux et, pendant un instant, j’ai cru qu’ils allaient s’écarter pour la laisser passer.
De là où j’étais, je n’entendais pas ce qu’ils lui disaient, je percevais juste leurs intonations, le son de leurs voix mielleuses. Ils l’ont d’abord laissé entrer dans leur cercle et faire quelques pas vers la porte du vestiaire puis ils ont commencé à la tripoter, à se coller à elle, à essayer de soulever son tee-shirt, à tirer sur son soutien-gorge. Bella se débattait, essayait de se dégager de leur étreinte mais les garçons ne voulaient pas la lâcher. Finalement ils ont réussi à lui enlever son tee-shirt et son soutien-gorge et les ont levés en l’air comme des trophées.
Bella se tenait, immobile, à quelques mètres d’eux. Elle se cachait les seins avec ses bras, le dos courbé, les cheveux lui tombant sur le visage.
Tout s’était déroulé si vite. Je n’avais même pas eu le temps de réagir. Mes pieds se sont décollés du sol et je me suis précipitée vers Bella tout en criant aux garçons que c’était des connards, des fils de pute et qu’ils n’avaient pas le droit de faire ça. « Vous n’avez pas le droit de faire ça, espèces de merdeux ! »
Mais pour les garçons, le jeu était terminé. Ils ne voyaient même plus Bella et se fichaient totalement de moi. Ils m’ont balancé son tee-shirt et son soutien-gorge au visage avant de tourner les talons et de partir en direction du vestiaire, comme si de rien n’était.
Bella a maladroitement essayé de se rhabiller, son soutien-gorge est tombé par terre mais elle ne l’a même pas ramassé. Elle est restée figée, les bras autour de ses seins. » (p.54-57)
(Trois garçons de Jessica SCHIEFAUER)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 10 Mars 2020 à 08:43
« T’étais un mec dans mon lycée, genre populaire. T’arrêtais pas d’insister pour qu’on aille boire un verre. Tu disais que j’étais différente des autres et que tu aimais mon côté noir… Un soir j’ai fini par dire oui. Tu voulais qu’on passe d’abord chez toi, tu m’as servi un verre et je me suis sentie bizarre. Une minute après, je ne pouvais plus bouger et tu étais sur moi. »
J’ai pas su quoi dire.
« Et évidemment, après, tu as mis une photo de moi à poil sur Facebook en te vantant d’avoir niqué la vampire du Lycée... »
Je savais toujours pas quoi dire. » (p.69)
« D’abord il y a eu mon oncle, quand j’étais petite. Et puis ce mec de mon lycée, le soir où il m’a droguée. Et tous ses copains me sont passés dessus après lui. » (p.158)
« Au lycée, il y avait tous ces élèves qui m’appelaient Vico la patate.. »
« Pourquoi tu ne les as pas simplement ignorés ? »
« Doc, vous étiez au lycée dans les années cinquante ou quelque chose comme ça. À l’époque, y avait pas les smartphones, Facebook, Twitter... Quelqu’un a fait un montage Photoshop de ma tête avec une grosse patate à la place de mon corps... Elle a circulé partout, TOUT le lycée l’a vue. Et quand on me croisait, on disait : « Hey regarde, c’est Vico la patate ! »
Une fois, c’est même arrivé alors que j’étais au supermarché. Ensuite, j’ai commencé à recevoir des messages qui disaient : « Débarrasse la Terre de tes kilos »,« Suicide-toi le gros »... Alors un soir, j’ai voulu le faire ! »
Le Doc s’est gratté la barbe.
« De plus en plus d’adolescents me parlent du harcèlement sur Facebook... » (p.72)
(Coeur battant d’Axl Cendres)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 28 Février 2020 à 08:51
« Je pensais au destin – j’y crois – qu’on l’appelle Nature ou Dieu ou Fatalité, toujours est-il qu’il est des mécaniques contre lesquelles on ne peut rien. Certains naissent pour réussir, briller, se distinguer, ET d’autres… je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour servir de point de comparaison. Après tout, pour qu’il y ait des géants, il faut des nains, non ? » (p.10)
« Ricanements – quatre ou cinq hyènes, comme je les appelle, se sont retournées vers moi et leur rire était mauvais. Pas de la moquerie, non, c’était pire que ça. C’est un rire qui bave, qui mord, qui fait saigner, et que je connais par cœur.
Je n’en voulais pas à Beaulieu, au contraire – ce que j’aime chez elle, c’est précisément son détachement absolu aux marques de distinction : le physique, les fringues, la classe sociale, le métier des parents, le collège de provenance ou les notes, semblent l’indifférer au plus haut point. Elle ne connaît qu’une règle : la sienne, celle qu’elle instaure dans son cours et qu’elle applique de manière intransigeante sans faire de quartier et sans nuance. Ma moyenne de 16/20 en français n’y changeait rien, j’étais bonne pour me coltiner une analyse de texte à la maison.
Ça n’a pas loupé, pas plus que les remarques à la sortie : « Bah alors, l’intello, t’as pas écouté la maîtresse ? », « En fait, c’est pas une punition, vu que t’es no life et que tu passes ta vie à travailler, elle t’a fait un cadeau, Beaulieu », « Oh la bibliothèque sur pattes, faut suivre en cours, t’es née pour ça ! ».
Ricanements sur le chemin du cours de maths, couloir du bâtiment C. Je marchais dans le sillage de Margot (un parfum sophistiqué), j’avais l’impression d’être invitée à porter la traîne de ses cheveux blonds, tombant gracieusement sur les formes rebondies de ses fesses parfaites, moulées dans un jean de marque. Elle était entourée de sa cour, véritable princesse de Clèves (le titre du texte dont je venais d’hériter pour faire ma punition) - «et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir de belles personnes. »
Je ne sais pas si j’aurais mieux supporté le harcèlement moral (je sais aujourd’hui qu’il s’agissait bien de cela, même si les adultes, à commencer par mes parents, relativisaient mes souffrances : c’est l’âge bête, sois plus forte que ça!), sans la présence de Margot qui me narguait par sa seule existence depuis l’école primaire.
(…)
J’étais contre les privilèges liés à la naissance, et pas uniquement contre la fortune, cette foutue cuillère en argent destinée aux bébés chanceux, mais contre l’apparence même, contre cette loterie de la génétique qui peut faire de notre vie un paradis ou un enfer. Au premier rang de son succès, je l’étais, donc, parce que non contentes d’avoir été scolarisées au même endroit et d’avoir choisi les mêmes options, nous portions des noms de famille dont l’initiale était identique, nous plaçant régulièrement l’une à côté de l’autre quand tombaient les fameux plans de classe. « Tu te retrouves encore à côté de la bolosse, ma pauvre chérie », lui disait-on de manière à ce que j’entende. « Nous fais pas un burn-out quand même ! » et de rire de plus belle.
Margot aussi riait, elle a toujours ri. Je ne peux pas dire qu’elle ait cherché à me nuire, simplement elle n’a jamais rien fait pour me protéger. Sauf une fois. C’est vrai.
Une pyjama party, en classe de cinquième. Je ne savais pas alors que j’avais été invitée pour devenir le centre d’intérêt, le jeu, l’attraction de la soirée. Le but était simple : faire manger le gros tas jusqu’à ce qu’il vomisse. J’ai vomi. On a voulu me faire manger encore, Margot a dit : « ça suffit, ce n’est même plus drôle. »
(…)
L’histoire a circulé, comme les photos prises ce soir-là – mon vomi sur les réseaux sociaux. Durant deux ans, on m’a surnommée « Dégueulis ». Les rares fois où j’ai été invitée par la suite, j’ai décliné. Je ne savais pas quel piège on allait me tendre. Je n’ai pas pris de risque.» (p.10-13)
« Les jours suivants, j’ai goûté avec un plaisir indicible cette paix qui m’était offerte. Je découvrais la tranquillité des journées où l’on ne m’adressait pas la parole, où je n’essuyais aucune moquerie, aucune morsure, où je pouvais me rendre d’une salle de cours à une autre sans redouter qu’on me crache au visage l’air de rien. Je n’étais pas transparente, loin de là. Les hyènes me surveillaient du coin de l’oeil, méfiantes, comme si elles avaient découvert brutalement que je n’étais pas le lapin qu’elles croyaient mais ne savaient pas encore à quel genre d’animal elles avaient affaire. » (p.43)
(Le mur des apparences de Gwladys CONSTANT)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 26 Février 2020 à 09:18
« Au premier abord... la violence ne se voit pas forcément...
- Ouvrez l'oeil ! - » (p.11)« - Vous avez été excisée. Vous avez une cicatrice à la place du clitoris. Heureusement vos petites lèvres ne sont pas trop abîmées.
- Et je pourrai faire l'amour ? Est-ce que je pourrai avoir du plaisir ?
- Vous pourrez avoir une vie sexuelle normale mais... sans orgasme. Moins de plaisir en tout cas.
Mais des chirurgiens peuvent réparer votre clitoris par une petite intervention. » (p.14)« - C'est la coutume ! Ils disent que ça nous garde pures.
- Non, c'est une invention de l'homme pour nous rendre dociles et soumises à leurs désirs !
- Oui, mais ils disent que c'est la religion qui l'ordonne.
- Mais c'est faux, et tu le sais bien.
Le CORAN ne dit rien sur l'excision. C'est un prétexte !
Ce sont des légendes d'hommes et des rites ancestraux.
(...)
- Mais Aïcha dit que les hommes peuvent contrôler notre plaisir sexuel.
Si on n'a pas de plaisir, on ne sera pas tentées de les tromper. » (p.15)« Le Code civil prohibe clairement le mariage contraint : selon l'article 146, "il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement". » (p.21)
Jeanne PUCHOL :
« La violence faite aux femmes, si elle ne débouche pas fatalement sur des actes, commence toujours par les mots, des mots qui semble-t-il, et c'est bien le problème, ne sont pas si graves que ça ... » (p.22)
« Le secrétariat d'état à la solidarité reconnaît que 70 000 adolescentes françaises de 10 à 18 ans sont potentiellement menacées de mariage forcé.
Ce type de mariage est illégal mais peut avoir lieu soit en France soit dans le pays d'origine.
Qu'il s'agisse d'un mariage traditionnel, non officiel, ou d'un mariage civil, il est subi par des jeunes filles qui sont parfois mineures.
Ces victimes des mariages forcés sont soumises à des rapports sexuels imposés par leur "mari", donc à des viols perpétrés avec la complicité de la famille. » (p.26)Isabelle BAUTHIAN :
Je ne suis pas féministe. Je ne me suis jamais sentie femme, et les agressions dont ces dernières sont victimes ne me touchent pas plus que celles subies par n'importe quel individu opprimé. Mais je crois au droit incompressible de chacun à disposer de sa vie selon ses aspirations et ses qualités propres, et je sais que la féminité y est souvent un obstacle. Je suis convaincue que c'est en abattant les a priori que nous contribuerons à changer les choses. (p.64)
(En chemin elle rencontre… - ouvrage collectif)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 28 Janvier 2020 à 09:33
« C'est une double peine
Tu viens de te faire violer donc on a considéré que TON CONSENTEMENT & TON CORPS valaient moins que la pulsion soudaine d'un type.
Tu décides de ne rien dire et tu as l'impression de faire le jeu des violeurs, en faisant ça.
Alors que c'est pas vrai.
LA VICTIME, C'EST MOI ET C'EST MOI QU'IL FAUT AIDER. » (p.25)
« Le viol, c'est quand même le seul crime où on remet SANS CESSE en cause la victime.
- T'es sûre ??!?
- T'as vu comment t'étais habillée ?
- Pourquoi t'as attendu si longtemps ?
- T'as pas l'air si traumatisée...
Quand tu te fais cambrioler, on te dit pas :
- Ah oui mais peut-être que tu pouvais mieux fermer la porte ?? !?
MAIS POUR UN VIOL, PAS DE PROBLÈME.
Ça crée aussi une honte associée au viol, personne n'ose en parler.
T'as honte, mais tu ne devrais pas.» (p27)
Cher corps de Léa BORDIER
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 8 Juillet 2019 à 15:44
"Il essayait de trouver une façon d'exprimer à Jerry le lien entre Frère Eugène, la salle dix-neuf et le fait de ne plus jouer au football. Il savait qu'il y avait un lien mais c'était difficile à exprimer.
"Ecoute, Jerry. Il y a quelque chose de pourri dans cette école. Plus que pourri." Il chercha le mot et le trouva, mais ne voulut pas l'utiliser. Ça n'allait pas avec le paysage, le soleil et le bel après-midi d'octobre. C'était un mot de l'ombre, qui allait avec le vent d'hiver.
"Les Vigiles ?" demanda Jerry. Il s'était allongé sur la pelouse et regardait la course des nuages dans le ciel bleu d'automne.
"ça en fait partie", dit Cacahuète. Il aurait voulu courir encore. "Le mal", dit-il.
"Qu'est-ce que tu as dit ?"
Dingue. Jerry allait croire qu'il avait perdu le nord. "Rien", dit Cacahuète. "De toute façon, je ne vais plus jouer au football. C'est personnel, Jerry." Il prit une profonde inspiration. "Et je ne vais pas non plus courir le printemps prochain."
Ils se turent.
"Qu'y a-t-il, Cacahuète ?" finit par demander Jerry, d'un ton ému rempli d'inquiétude.
"C'est ce qu'ils nous font, Jerry." C'était plus facile à dire parce qu'ils ne se regardaient pas, chacun assis à sa place. "Ce qu'ils m'ont fait cette nuit-là dans la classe... je pleurais comme un bébé, ce que je ne me serais jamais cru capable de faire. Et ce qu'ils ont fait à Frère Eugène en détruisant sa salle, en le détruisant lui..."
"Allons, t'inquiète pas, Cacahuète."
"Et ce qu'ils te font à toi... les chocolats."
"Ce n'est qu'un jeu, Cacahuète. Prends ça comme une blague. Laisse-les s'amuser. Frère Eugène devait sans doute être au bord de..."
"C'est plus qu'une blague, Jerry. Quelque chose qui peut te faire pleurer et faire partir un professeur... le faire basculer... c'est plus qu'une simple blague." (p.130-131)
"Jerry pensa qu'il comprenait le sens du geste de janza – Janza brûlait de l'envie d'agir, de toucher, de se battre. Et il devenait impatient. Mais il ne voulait pas commencer le premier. Il voulait pousser Jerry à le faire, c'est ainsi qu'agissaient ceux qui brimaient les autres, pour se sentir innocents après le délit. C'est lui qui a commencé, clamaient-ils." (p.173)
(La guerre des chocolats de Robert CORMIER)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 6 Juillet 2019 à 15:47
"Il était question d'un congrès en province et d'un dîner très arrosé. Ils s'étaient attardés dehors avec quelques collègues, tous très éméchés, lorsqu'une jeune femme qui avait participé au colloque, mais qu'ils ne connaissaient pas, était passée devant eux. L'un d'eux l'avait interpellée, pour rigoler.
"...tu peux me croire qu'elle serrait les fesses !" a-t-il lancé au moment où je revenais pleinement à la conversation.
Tout le monde a ri. Les femmes aussi. Je suis toujours étonnée que les femmes rient à certaines blagues.
- Ah bon, l'ai-je interrompu, elle serrait les fesses ? Cela te surprend ?
Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre.
- Tu veux que je t'explique pourquoi ?
Il regardait les autres l'air de dire : voilà, de quel genre de femme le destin m'a affublé.
- Parce que vous étiez quatre mecs bourrés dans une zone d'activité déserte, pas loin d'un hôtel Ibis ou Campanile quasiment vide. Eh bien oui, William, cela fait sans doute partie des différences essentielles entre les hommes et les femmes, fondamentales, même : les femmes ont de très bonnes raisons de serrer les fesses.
(...)
Je me suis adressé à William mais aussi aux deux autres hommes de l'assemblée.
- Est-ce que vous serrez les fesses lorsque vous croisez un groupe de jeunes filles manifestement ivres en pleine nuit ?
Le silence épaississait à vue d'oeil.
- Eh bien non. Parce que jamais aucune femme, même ivre morte, n'a posé sa main sur votre sexe ou vos fesses, ni accompagné votre passage d'une remarque à caractère sexuel. Parce qu'il est assez rare qu'une femme se jette sur un homme dans la rue, sous un pont, ou dans une chambre pour le pénétrer ou lui enfoncer je ne sais quoi dans l'anus. Voilà pourquoi. Alors sachez que oui, n'importe quelle femme normalement constituée serre les fesses lorsqu'elle passe devant un groupe de quatre types à trois heures du matin. Non seulement elle serre les fesses mais elle évite le contact visuel, et toute attitude qui pourrait suggérer la peur, le défi ou l'invitation. Elle regarde devant elle, prend garde à ne pas presser le pas, et recommence à respirer quand enfin elle se retrouve seule dans l'ascenseur." (p.144-146)
(Les loyautés de Delphine de VIGAN)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 12 Janvier 2019 à 11:44
"De nos jours, les gens parlent et ne savent même plus ce qu'ils disent, exactement comme le mec que j'ai eu le malheur de croiser ce jour-là (...). C'est un peu comme dans le couloirs du lycée. Certains garçons se traitent de "bâtard", comme si c'était un mot gentil, affectueux. Et si vous leur demandez le sens de ce mot, je ne suis même pas sûre qu'ils sauront vous répondre. Ils l'emploient parce qu'ils l'ont entendu. C'est tout. On est en train de devenir des perroquets." (p.9-10)
"Des fois, on me dit aussi que je suis canon. Canon, ça veut bien dire ce que ça veut dire : je corresponds au goût de l'époque, quoi. C'est tout. Je lui corresponds et puis je m'y conforme aussi, niveau fringues, shoes, maquillage. Je suis à la page, quoi, comme on dit. Ça peut sembler superficiel, mais je vais vous dire, ce ne sont pas les nanas qui sont superficielles, c'est la société. Les nanas, elles s'adaptent. C'est facile après de le leur reprocher. Parce que, de toute façon, on leur reprochera quelque chose, quoi qu'elles fassent... En clair : une fille qui est grosse et moche : on va se foutre de sa gueule. Une quelconque, on va lui dire qu'elle pourrait se mettre en valeur. Et une fille jolie qui fait des efforts, elle va se faire traiter de pétasse. On pensera qu'elle est superficielle, qu'elle n'a rien dans le crane. Donc une fille sera toujours ramenée à son apparence et aura forcément tord en prime. Finalement, on vit dans une société qui met la beauté plastique au-dessus de tout, tout le temps, partout, tu peux pas faire un pas dans la rue sans tomber sur une splendeur grand format, sur un panneau d'affichage ou au cul d'un bus, et quand tu ressembles à cette beauté qu'on te jette à la figure en permanence, tu te fais insulter et emmerder dans la rue. Dans ce monde, le problème pour une fille, c'est même pas d'être comme ci ou comme ça, c'est d'exister. Tout court. Notre société fait en sorte que la femme ne puisse pas être satisfaite de ce qu'elle est. Et du coup, elle veut toujours être une autre personne." (p.13-15)
"Dans ma classe, il y a une fille, on va l'appeler Carla, d'accord ? Comment vous expliquer ? Elle est grosse, et elle est moche. C'est dégueulasse de dire ça, mais c'est la vérité. Des boutons plein la figure, des cheveux fins et gras, un double menton, et de petits yeux trop rapprochés. Dans son dos, on l'appelle "gros tas" ou "face de cul". Je pense que sa vie au lycée doit ressembler à l'enfer. Des pals et des flammes. Forcément, elle compense : la bouffe et les jeux vidéo. C'est une geek. Mais geek ne veut pas dire cool, contrairement à une idée répandue. Sauf que, le moment où je l'envie, c'est quand elle sort du lycée. Parce que je suis à peu près sûre que dans la rue on ne l'aborde pas pour lui demander son 06, on ne la siffle pas, elle ne se sent pas en danger. Elle rase les murs, elle passe inaperçue. C'est à ce moment précis, donc, quand on sort du lycée, que nos réalités à elle et moi s'inversent. (...) Une fois dehors, d'ici à ce que j'arrive chez moi, ma beauté n'est plus un atout. Je me fais accoster jusqu'à dix fois. N'allez pas imaginer qu'on m'accoste gentiment, pour me flatter et me lancer des fleurs (...). Non, là, j'ai plutôt droit à des mots comme "pétasse", "chaudasse", "t'es bonne", "vas-y, tu t'appelles comment ?" Et si je ne réponds pas, des fois, on me suit, et je suis obligée de marcher plus vite. Il y a plein de gens autour de moi, OK, mais je suis seule, terriblement, parce que les gens, ils tracent leur route, rien à faire qu'un mec m'emmerde – et encore un mec, un seul, c'est quand j'ai de la chance !" (p.16-18)
"Finalement, un temps ça m’a reposé d’être regardée comme une excentrique ou une malade en phase terminale plutôt que comme une marchandise consommable. Notre société dit aux femmes qu’elles doivent être belles mais elle leur donne envie d’être laides." (p.24)
"Quel est mon message ?... Tout simplement que la condition de vie des femmes régresse. Peut-être que la parité est davantage respectée au gouvernement, mais la rue n'est pas l'Assemblée nationale, et en matière de respect, la rue prend parfois des allures de foutoir.
(...)
Ce que j'entends quotidiennement laisse des marques autrement plus profondes... Comme un mal immergé qui ronge l'intérieur. Et de fait, extérioriser ce mal, le projeter à l'extérieur, l'envoyer à la gueule du monde, est finalement plus violent pour les autres que pour moi." (p.29-31)
"Aujourd'hui je pense surtout aux autres, jeunes filles, jeunes femmes, et j'ai peur pour les plus fragiles, pour celles qui se mutileront tout autrement, pour celles qui s'immoleront par le feu, par le médicament, par le sang. Ça arrivera forcément. C'est peut-être déjà fait, et je l'ignore parce que je ne sais pas tout, parce qu'on ne sait pas tout, parce que pour les journalistes comme vous, il y a trop de détresse à couvrir... Et chaque fois qu'on montre quelque chose, on devrait penser que dans le même temps on cache autre chose... Et ce que l'on choisit de montrer dit aussi précisément ce que l'on choisit de voiler." (p.38-39)
(De si beaux cheveux de Gwladys CONSTANT)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"