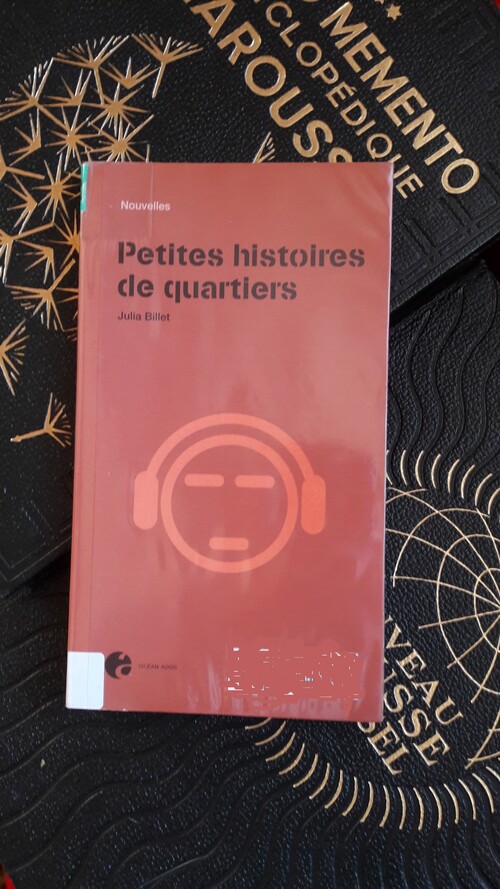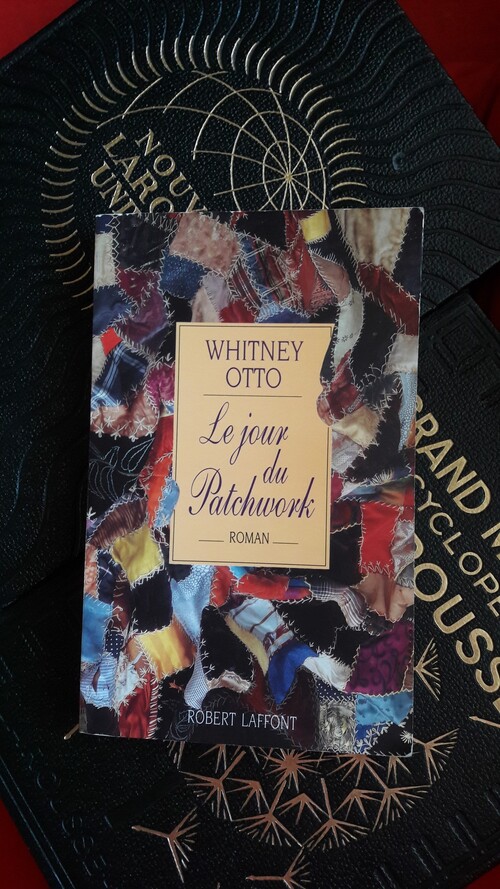-
Par La Célestine le 12 Juin 2017 à 16:37
« Il déroute d'abord celui, ou celle, qui des années durant avait appris à deviner les désirs et les réactions du compagnon de vie. Après tant d'années partagées, découvrir que l'autre cesse d'être un autre soi-même pour devenir un étranger est source d'une blessure indicible, d'une douleur immense. C'est une déchirure souvent plus difficile à porter qu'une mort imprévue. C'est une nouvelle rencontre qui s'amorce, une nouvelle vie qu'il faut inventer. C'est un monde nouveau où tout se mêle, sans logique apparente ni repères visibles, qu'il faut affronter. » (p.11-12)
« ...l'aidant ? Ce terme affreux dont on a affublé le compagnon de vie qui accompagne le départ de l'autre vers un ailleurs de plus en plus inaccessible. » (p.18)
« Il prendra son temps puisque, à chaque pas, il oublie le précédent et l'échéance dont il se rapproche. Sur ce chemin dont nul ne connaît la longueur, mais tous l'issue, il perdra chaque jour un fragment de lui-même et de leur histoire. On se fait à l'idée de la mort. Mais comment va-t-elle faire désormais avec celui qui est là sans être là ? Peut-on faire le deuil d'un être vivant ? » (p.20)
« Elle, (…) va entrer dans le temps de la colère, qui s'infiltre en elle comme une inondation sournoise puis explosive. Phase nécessaire du deuil, dit-on. Mais il est encore là et subit sa colère. L'amour, la tendresse, la compassion se mêlent à sa violence. Rage de détresse. Elle ne le supporte plus, c'est de sa faute, il est responsable, le médecin l'a dit. Elle a envie de le battre, de le prendre dans ses bras, de le protéger, de le tuer. Dix mois de lutte avec ses démons vont s'engager. Sa traversée de l'enfer. Elle combat, il s'absente. Elle pleure, il la regarde, étonné. » (p.32-33)
« Non pas que j'ai envie de hurler à l'injustice lorsque, au moindre signe d'agacement, il se plaint : « Tu me parles toujours mal. » Ce « toujours », un poignard de reproche qui creuse à chaque fois plus profond mon impuissance, mon incapacité à n'être qu'amour, tendresse, patience infinie. » (p.45)
« Nous avons partagé trente ans de vie commune. Une telle intimité de pensée et de sentiments avait entretenu le mirage d'un paysage familier. J'étais certaine que je savais tout de lui, que rien ne m'avait échappé de ses moindres frémissements. Et voilà que je ne le reconnaissais pas, il s'échappait, s'enfuyait et se réfugiait dans des espaces inaccessibles. Un puzzle éclaté. Une géographie inconnue. Des pièces manquantes, des morceaux non identifiés impossibles à placer ou déplacer. » (p.46-47)
« J'ai cessé de me demander si la maladie d'Alzheimer est un accident ou une malédiction programmée depuis longtemps. A l'instar des neurones, je me suis derechef assigné une nouvelle mission. Voilà, je tenais le fil, j'avais la vision de ce que je devais faire désormais : aider ce cerveau maltraité à réorganiser ce qui pouvait l'être encore ! J'étais cependant suffisamment lucide pour ne pas m'engouffrer dans l'hypothèse illusoire d'une guérison. Simplement, je me trouvais enfin un rôle minuscule, une infime chance d'agir dans ce déroulement implacable de la maladie qui nous anéantissait. » (p.54)
« Tu n'en veux plus depuis longtemps de mon désir incessant de faire et de défaire, de construire et de réaliser des projets qui se sont les uns après les autres fracassés contre ta résistance douce, puis passive, et enfin ton effacement. » (p.77)
« Tu veux seulement que je reste assise à côté de toi, main dans la main. Tu es devenu mon guide aveugle vers les ténèbres. Je suis devenue l'otage de ta maladie. Je suis ta prisonnière. » (p.78)
« Je m'obstine à inventer notre mythe, je cherche encore un refuge pour nous deux, à l'abri d'un monde que tu as fui et où je ne trouve plus notre place. » (p.79)
« Chose inhabituelle, j'ai moi aussi été accueillie et écoutée. On m'a raconté la vie ici, une vie aménagée pour prendre soin de ces exilés d'une société qui ne peut plus ou qui ne sait pas encore assumer leur état. J'ai découvert un camp dont les réfugiés sont désormais à l'abri de nos peurs face au mystère qu'ils nous opposent.
Énigme que les soignants ont choisi de côtoyer sans forcément la comprendre. Ils ont pris le parti d'accompagner des personnes plutôt que des malades, d'accéder à leurs souffrances, à leurs désirs, à leurs goûts, à leurs demandes, sans nécessairement chercher à les expliquer. » (p.89)
« A la fin de la séance, j'interroge Virginie. Question tout droit sortie du dehors, de là où il faut des résultats, de la performance. « Vous les voyez faire des progrès ? » Un grand sourire modeste accompagne la réponse : « Je suis juste là pour leur donner du bien-être."
(…)
On s'interroge, on s'inquiète, deviendra-t-il un jour nécessaire d'obtenir des résultats pour continuer à s'occuper d'eux ? Pourrons-nous longtemps encore dire avec Virginie que seul compte « leur bien-être » ? Ces patients sont dérangeants. (…) Un miroir embarrassant pour notre société qui ne sait plus que faire de ces gens tombés du train en marche. » (p.100-101)
« Dans l'intensité de cette vie qui s'écoule loin des considérations neurologiques et médicales, on ne suit pas des malades, on accompagne des personnes. Tous ont la ferme croyance que malgré et au-delà de toutes les pertes apparentes subsiste une zone indemne. A chaque instant, c'est « cette part intacte de leur âme » qu'ils cherchent à contenter. » (p.106-107)
« Nathalie s'est assise auprès de Simone qui, dans un douloureux moment de lucidité, pleure sur son épaule. Tout à coup, une question se fraie un chemin au milieu des larmes :
« Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
- C'est pour que vous puissiez poser votre tête sur mon épaule. » » (p.117)
(Alzheimer mon amour de Cécile HUGUENIN)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 6 Juin 2017 à 11:13
La poche du devant
(d'après « La besace, I 7 » de Jean de La Fontaine)
« Cherchant son bonheur
Un grand producteur
Vit que sous les projecteurs
Sans se faire prier
Devant la télé
On aimait se déballer
Il dit ma formule
A coup sûr plaira
Car le ridicule
Ne les effraie pas
Et sans artifice
Une fois par mois
Il faut que l'on puisse
Se plaindre de soi
Nos petits travers
Ils sont par derrière
Dans la poche revolver
Tandis que les grands
De tous les autres gens
Sont dans la poche du devant
On vit sans façon
A son émission
Se presser des laiderons
Tous les bas-du-cul
Tous les nez tordus
Les bancals et les bossus
Sans aucune honte
Venus s'exhiber
Devant les grands pontes
De la Faculté
D'effroyables trognes
Des corps rabougris
Plaignaient sans vergogne
Les défauts d'autrui
Nos petits travers
Ils sont par derrière
Dans la poche revolver
Tandis que les grands
De tous les autres gens
Sont dans la poche du devant
On vit des tonneaux
De deux cents kilos
Dénoncer des haricots
Puis des maigrelets
Trouver plus que laid
D'arborer cuisse ou mollet
On vit les filasses
Plaindre les rouquins
Les chatains fadasses
Critiquer les bruns
D'énormes babines
Vouer sans merci
Les lèvres mutines
A la chirurgie
Nos petits travers
Ils sont par derrière
Dans la poche revolver
Tandis que les grands
De tous les autres gens
Sont dans la poche du devant
Et finalement
Chacun se trouvant
Tout-à-fait satisfait
Se tourna sur l'heure
Vers le producteur
Remarquant pour son malheur
Son nez en trompette
Ses yeux divergents
Son coup de belette
Et ses pieds trop grands
D'horribles sourires
Des airs goguenards
Semblaient tous lui dire
Alors mon gaillard
Nos petits travers
Ils sont par derrière
Dans la poche revolver
Tandis que les grands
De tous les autres gens
Sont dans la poche du devant
Anne SYLVESTRE chante... au bord de La Fontaine (1997)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 6 Mai 2017 à 13:39
« - Écoute, maman. Quand on te regardera comme un animal curieux à longueur de journée, tu comprendras... Quitte à être voyant, autant l'être vraiment !
Bouli refuse de se fondre dans le décor. Son handicap et sa prothèse roulante sont suffisamment présents pour qu'il n'essaie pas de passer inaperçu.
Alors il choisit le contre-pied pour éliminer l'adversaire.
Bouli est un ovni bariolé dans la grisaille du collège? Bouli est le type qui se balade dans une tenue extravagante.
Il n'est plus ce garçon handicapé qu'on plaint par-derrière en faisant semblant de ne pas s'en apercevoir par-devant. » (p.147-148)
(Désobéis ! De Christophe LEON)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 12 Avril 2017 à 13:42
« Douze ans & en sixième & maintenant je portais des lunettes & j'étais dégingandé, maigre, des poils sous les bras, à l'entrejambe & leurs yeux glissaient sur moi, même les professeurs & en classe de gym je refusais d'aller à la douche refusais de me promener nu parmi eux & leurs bites luisantes & en train de se gratter le torse, le ventre, certains si musclés, si beaux & riant comme des singes sans deviner sauf s'ils me voyaient & mes yeux toujours en mouvement bondissant & filant parmi eux comme des vairons s'ils me voyaient ils savaient & leur visage se durcissait de dégoût PÉDÉ PÉDÉ QUENTIN EST UN PÉDÉ & ce jour où Papa a foncé au premier où je faisais mes devoirs dans ma chambre & m'a tiré par le bras & traîné en bas & dans le garage & montré les revues Body Builder & la poupée Ken nue de la cour de récréation rapportée cachée derrière des piles de vieux journaux & il l'avait trouvée le visage marbré & furieux & à ce moment-là Papa portait une barbiche comme le docteur M... K. & elle aussi était blanche d'indignation. Serrant les revues à deux mains comme s'il tordait le cou d'un poulet pour s'épargner la vue des couvertures & des dessins que quelqu'un avait faits dessus au feutre rouge fluorescent. & aussi l'intérieur avec d'autres dessins du même genre sur les doubles pages centrales de corps mâles musclés & ce jeune type ressemblant à Barry quand il aurait été plus vieux & avec pas mal de kilos en plus & la banane rose vif toute droite entre ses cuisses & des parties de certaines photos découpées aux ciseaux. « C'est malsain Quentin » la bouche de Papa remuait, haletait, « c'est dégoûtant je ne veux plus jamais jamais revoir des choses comme ça de ma vie. Nous n'en parlerons pas à ta mère » sur le point d'en dire davantage mais la voix lui a manqué. » (p .41-42)
(Zombi de Joyce Carol OATES)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 8 Avril 2017 à 15:27
« - Tu sais depuis combien de temps je suis amoureuse de toi? demande-t-elle en me rendant les avirons.
J'évite de risquer une réponse qui pourrait me faire passer pour inattentif ou prétentieux.
- Cinq minutes. Quand, après m'avoir embarquée, tu as loué un troisième ciré et que tu es allé abriter mon fauteuil.
Mes yeux se posent sur la tache jaune entre les pins au loin. Mon souci était d'éviter qu'elle ne se trempe les fesses au retour, mais ce qui semble l'avoir touchée davantage, c'est ma façon de traiter son compagnon de route comme une part d'elle-même. »
« En face d'elle, un garçon de quinze ans, recroquevillé dans un fauteuil électrique, le corps sanglé à son dossier, lisait un roman.
Concentré, absorbé, isolé des bruits de flipper et de Nintendo. Toutes les minutes et demie, son visage se contractait et c'était la torture : il devait s'y reprendre à dix fois pour commander son geste, rassembler ses forces, coordonner ses mouvements et finalement réussir, au prix d'un effort de volonté intense, l'opération si simple de tourner la page.
-Et tu sais ce qu'il y avait alors, dans ses yeux ? Du plaisir. Du plaisir devant ces mots étalés face à lui, gagnés à la sueur de son front ; du plaisir plus fort que la peine et la contrainte qui l'attendaient au bas de la page suivante. C'est ce petit corps tordu au dessus d'un roman qui m'a appris qu'on pouvait toujours être libre. »
« Si je vous avais dit qu'elle a ce handicap, vous l'auriez traitée comme telle et vous seriez passés l'un à côté de l'autre, parce qu'elle n'a pas changé, Thomas : elle n'est pas résumable à ce fauteuil. »
(La Demi-pensionnaire de Didier van CAUWELAERT)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 28 Mars 2017 à 08:24
« Avec ces Petites histoires de quartiers, j'ai eu envie de mettre en lumière des inégalités du quotidien, celles que l'on croise ou que l'on subit, qui n'ont souvent l'air de rien mais qui font mouche et mal.
Inégalités parce que l'on est d'un sexe plutôt que de l'autre, qu'on est plus ou moins clair de peau, plus ou moins riche, plus ou moins français, qu'on est plus ou moins dans la « normalité ».
(…) Je crois profondément que chacun de nos gestes, chacune de nos actions peuvent faire tourner la terre autrement : nous construisons l'humanité ; c'est à nous de tracer le chemin sur lequel nous avons envie d'avancer. » (Préface p.8)
(Petites histoires de quartiers de Julia Billet)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 26 Mars 2017 à 08:27
« Dans les années quarante, les femmes quittèrent l'univers domestique pour combler le vide laissé par les hommes (désormais mobilisés) dans les usines de munitions ou pour aller s'asseoir dans les cabanes solitaires des postes d'aiguillage, le long des voies ferrées. Pour la première fois, des femmes mariées travaillaient hors de chez elles ; ce n'étaient plus seulement les jeunes filles ou les vieilles filles ou les femmes pauvres. Les effectifs de la main-d’œuvre féminine augmentèrent de 57 pour 100.
Néanmoins, il n'y avait toujours pas de femmes médecins. Pas de femmes prenant des décisions au plus haut niveau. Pas de salaires égaux. Et, quand les hommes revinrent de la guerre, ce fut le retour au foyer, où l'on vous encouragea à trouver de nouvelles recettes pour les dîners de famille, à contrôler les devoirs des enfants que l'on vous priait de mettre au monde – des enfants qui avaient besoin d'être attendus par leur mère quand ils rentraient à la maison après l'école, tout comme les maris s'attendaient à trouver leurs femmes à la porte, leur tendant un Martini pour les requinquer, tandis que l'odeur du dîner en train de mijoter emplissait la maison. » (p.153-154)
(Le jour du patchwork de Whitney OTTO)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 24 Mars 2017 à 09:35
« - Pourquoi tu m'as dit que ton père était mort ?...
- Parce qu'en réalité, il est en prison !... et que j'en ai honte ! » (p.22)
« Depuis que mon père est en prison, on a été obligés de déménager trois fois. A chaque fois que les voisins apprenaient pour lui, on était montrés du doigt... » (p.32)
(Tendre banlieue Tome 19 : L'absence de Tito)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 22 Mars 2017 à 09:37
"- Homosexuel ?
- Oui... Sous le IIIè Reich, l'Alsace, la Moselle et l'est de la France étaient devenus des provinces allemandes. Clément a été condamné en vertu du paragraphe 175 qui pénalisait le simple contact visuel ou physique entre deux personnes de sexe masculin. Le chef des SS, Heinrich Himmler, menait sa croisade contre les homosexuels. Dès leur arrivée dans les camps, ces bourreaux demandaient aux garçons de se distinguer des autres en apposant un triangle rose à hauteur de leur poitrine. Sur leur maudite veste rayée. » (p.77)
« A cause de quoi ? Parce qu'Himmler, le chef des SS, reprochait aux homosexuels de ne pas procréer...
« L'homosexualité fait échouer tout rendement, tout système fondé sur le rendement : elle réduit l'Etat dans ses fondements. A cela s'ajoute le fait que l'homosexuel est un homme radicalement malade sur le plan psychique... Il faut abattre cette peste par la mort ! » (Dixit Himmler dans son discours du 16 novembre 1940) » (p.87-88)
« D'autres mouraient sous le scalpel des apprentis médecins... Morts d'avoir aimé un jour, une nuit un être du même sexe. Sur un chemin de traverse. Hors les normes. Morts, le sang contaminé par des injections à base de sulfure, de térébenthine ou d'hormones synthétiques... Recherches fantaisistes sur la malaria, la fièvre jaune... Piqûres dans l'aine droite pour obtenir une inversion des tendances de l'individu, piqûres d'extermination contre les « déviants criminels ». A Buchenwald, Dachau, Ravensbrück, Auschwitz...
Clément est juste mort d'avoir aimé Hans. Rien d'autre n'a jamais pu justifier son décès. » (p.91)
(Les roses de cendre d'Erik Poulet-Reney)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La Célestine le 20 Mars 2017 à 09:43
« ...ces droits qui se rapportent à la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus élémentaire et immédiat : avoir un toit, manger à sa faim, se laver, se soigner, en somme participer aux formes les plus simples de la vie sociale." ; " c'est bien la nature indivisible des droits de l'homme qui se trouve ici en question. Le droit à une vie décente, le droit au logement, le droit aux soins de santé, le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la participation sociale et politique doivent être considérés comme des droits fondamentaux de l'homme" » (p.9 de la Préface de Pierre-Henri Imbert)
« Fondamentalement, les droits de l'homme sont le droit d'être un homme et surtout que ce n'est pas pour le respect des droits qu'il faut se battre mais pour le respect des personnes privées de ces droits ; car chaque droit doit avoir pour nous un visage. » (p.10 de la Préface de Pierre-Henri Imbert)
« Là encore, je retrouvais des familles traitées en objets de mesures, d'aide et de contrôle, plutôt qu'en sujets de droit. Des familles n'ayant pour seule identité qu'une appellation négative : « asociales », « inadaptées » « lourdes » « familles à problèmes » la seule étiquette à peu près neutre de « sans-abri » leur étant peu à peu subtilisée. » (p.18)
« Sans domicile reconnu, sans travail, sans carte d'électeur, mais aussi sans possibilité de faire inscrire les enfants à l'école, la famille était poursuivie pour squattage. (…) Curieusement, la famille avait un dossier auprès des instances judiciaires, alors qu'elle n'existait pas pour les instances scolaires ou de relogement. » (p.20)
« Car la précarité de l'habitat engendre l'insécurité des relations, de l'amitié entre voisins, de l'amour entre époux, entre parents et enfants. Naissent alors le désordre et la violence. Ainsi, les familles, par leur misère, deviennent peu à peu des indésirables, sources de répugnance et de peur pour leur environnement. » (p.21)
« Le pire des malheurs est de vous savoir compté pour nul, au point où même vos souffrances sont ignorées. Le pire est le mépris de vos concitoyens. Car c'est le mépris qui vous tient à l'écart de tout droit, qui fait que le monde dédaigne ce que vous vivez et qui vous empêche d'être reconnu digne et capable de responsabilité. » (p.23)
(Les plus pauvres, révélateurs de l'indivisibilité des droits de l'homme de Joseph Wresinski)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"