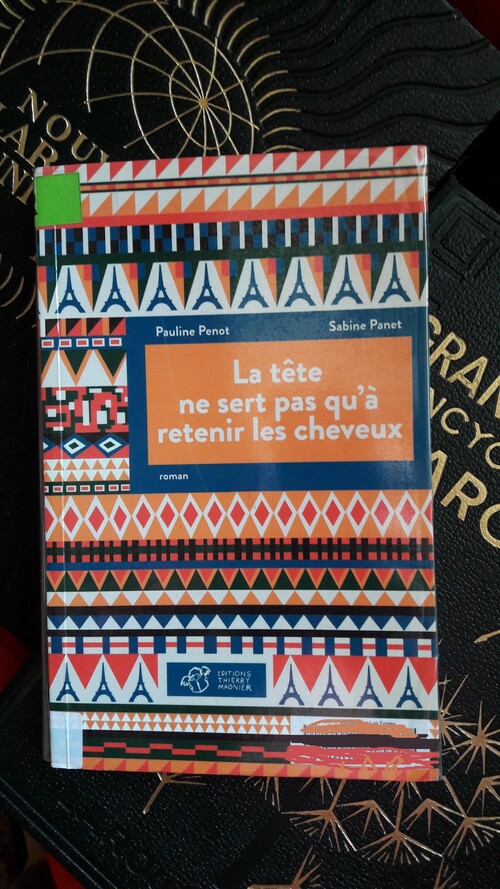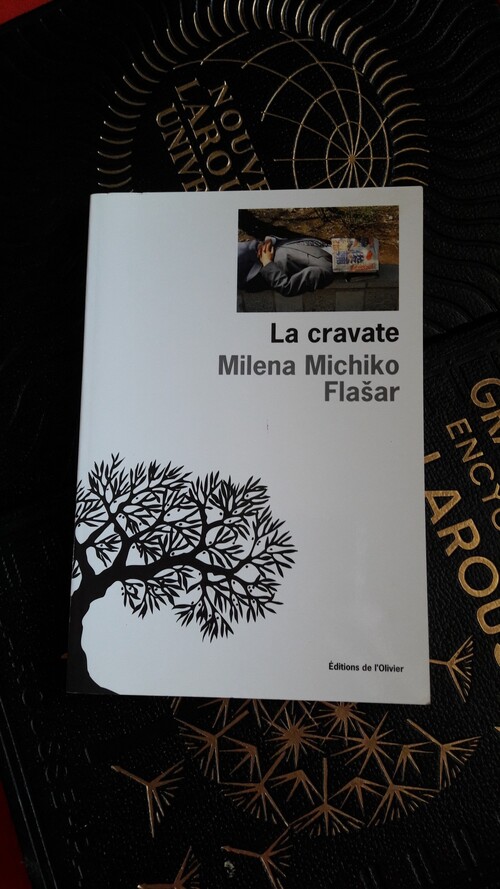-
« L’hospice voisin était un endroit où se retrouvaient tous les gens dont personne ne voulait. Si vous aviez des difficultés à marcher, si votre visage était tordu, si votre voix sortait toute mâchonnée et que vous entendiez mal, si vous étiez vieux et que vous aviez oublié de vous souvenir, voilà où vous terminiez la course. » (p.122)
(Des bleus au coeur de Louisa REID)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« - Vous savez, chez nous, une femme qui n’est pas excisée n’a aucune chance de faire un bon mariage. Elle va se faire moquer, traiter de n’importe quoi, elle ne pourra pas prier à la mosquée avec les autres femmes de son groupe d’âge, ni manger dans le même bol qu’elles. J’avais une cousine de Dakar qui n’était pas excisée : c’est elle-même, à vingt ans passés, qui est allée voir la forgeronne du village pour lui demander de le faire, parce qu’elle n’en pouvait plus de vivre comme une demi-personne. Tout ça pour vous donner une idée du poids des traditions.
(…)
Tout à l’heure, devant les grilles du collège où j’allais chercher ma petite fille, j’ai parlé avec la mère d’une gamine qui portait un appareil sur les dents, une machine très vilaine et qui avait l’air de lui faire mal. J’ai demandé à la dame pourquoi elle avait collé ça sur les dents de sa fille. Nous, jamais on ne forcerait nos enfants à porter des dentiers en métal tous les jours pendant des années, avec toutes les complications qui s’ensuivent. Mais cette mère-là m’a dit que dans votre société c’était très important d’avoir des bonnes dents bien droites, et que même sa propre fille lui serait reconnaissante un jour.
- Excusez-moi, mais on ne peut tout de même pas comparer les conséquences néfastes de l’excision avec les désagréments des appareils dentaires, intervint François Cabanon.
- Je crois au contraire que la comparaison de madame Bocoum est très juste, s’interposa Rose-Assata. Elle illustre les pressions sociales. Ici, une mère qui aime sa fille va vouloir lui offrir des dents correctement alignées, ou des oreilles bien collées. C’est cher et pénible, mais ça vaut le coup. Au Fouta, une mère qui veut un bon avenir pour son enfant, dans la société dans laquelle elle vit et où ses choix sont limités, va la faire exciser. Bien sûr, l’excision a des conséquences ravageuses, bien plus que l’orthodontie ou la chirurgie plastique, mais je crois que le message est clair : parlons de l’excision, oui ; dénonçons cette pratique, oui ; mais évitons les clichés. Les violences envers les femmes ne sont pas une spécialité africaine.
- Mais pourquoi faire ça ? demanda une professeure d’allemand au deuxième rang. Je ne comprends pas à quoi ça sert.
Rose-Assata s’approcha du micro :
- On entend beaucoup d’histoires sur les origines de l’excision. Certains disent qu’elle remonte à Sarah, la femme d’Abraham. D’autres parlent des pharaons : quand les momies ont été examinées, on a découvert des femmes complètement fermées, coupées et puis recousues ensuite, comme le sont les Somaliennes aujourd’hui. Il me paraît clair, pour répondre à votre question, que l’excision procède, historiquement, d’une volonté de contrôle sur les femmes.
- ça n’explique pas pourquoi ça continue, insista la professeure, butée.
- Des marchands des empires pharaoniques ont fait fortune en commerçant le long du Nil jusqu’au Kenya actuel et à travers le Sahara, qui n’est pas seulement un désert, mais aussi un lieu de trafic très dense. Dans les villes que les caravanes traversaient, on regardait avec envie ces hommes riches, qui n’épousaient que des femmes belles et excisées. Les populations locales se sont mises à exciser leurs filles pour accéder à des mariages avantageux : c’est l’une des façons dont la pratique s’est diffusée, couche après couche, depuis le haut d’une pyramide sociale très hiérarchisée. D’autant plus facilement que les sociétés exigeaient déjà chasteté, pureté et modestie de la part des femmes. Une fois propagée, l’excision n’est plus une option : tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait. C’est ce qu’on appelle une norme.
- Vous parlez des pharaons alors que je pensais que c’étaient les musulmans qui avaient inventé l’excision, réagit quelqu’un dans la salle.
Nawdé fit claquer sa langue dans le micro :
- Je le croyais, moi aussi. J’ai appelé l’imam de mon village quand j’étais à l’hôpital, car il est très savant et c’est lui qui a instruit mes trois enfants en religion. J’ai été étonnée quand il m’a dit que l’excision n’est pas une pratique religieuse. Les Saoudiens de La Mecque ne le font pas, et le grand mufti du Caire a même interdit de haddinde les petites filles. J’étais choquée, je lui ai demandé pourquoi il ne nous avait jamais dit ça. Il m’a répondu que c’était une affaire qui ne concernait pas le Saint Coran mais qu’il voulait bien aider à y mettre fin, puisque le chirurgien m’avait expliqué combien c’était mauvais pour la santé.
La voix de Nawdé faiblissait et Rose-Assata enchaîna :
- ça a concerné des chrétiens, des animistes, et même des juifs éthiopiens. Chez moi, en Guinée, certains marabouts disent qu’il faut le faire, même si c’est puni par la loi, pour que les filles ne fassent pas de bêtises. Quand vous habitez quelque part où tout le monde veut continuer, c’est très difficile d’être la seule à dire non. » (p.214-217)
(La tête ne sert pas qu’à retenir les cheveux de Pauline PENOT et Sabine PANET)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Je n’ai pas tout compris, mais j’ai senti au dedans de moi que leurs rires me rejetaient. La colère est montée et je me suis précipité sur la grande qui, d’une poussée m’a refait rouler dans le torrent. Alors tout dégoulinant d’eau froide, j’ai couru vers le soleil couchant, poursuivi par le ricanement des gamins qui résonnaient dans ma tête : « FADA… FADA ». J’ai couru si loin, que je suis tombé de fatigue. Julien n’était pas là, j’étais seul, j’avais envie de me jeter dans l’auge du cochon pour qu’il me mange, mais j’avais peur que ça fasse mal ! Alors je me suis couché dans le champ, et j’ai pleuré, pleuré de grand chagrin et de désespérance, des larmes du fond du ventre qui faisaient mal à sortir. Je ne savais pas pourquoi mais je sentais que rien, rien ne serait plus jamais pareil.
A force de pleurer, je me suis endormi et c’est au crépuscule que mon père m’a trouvé. Il m’a pris dans ses bras. Écroulé de fatigue j’ai juste pu lui demander avant de me rendormir :
- C’est vrai que je suis un fada ?
(…)
- Qu’est-ce que c’est un Fada, maman ? C’est vrai que je suis un Fada ?
Délaissant les pis de la chèvre, elle m’a pris sur ses genoux et m’a dit :
- Les gens ne sont pas tous gentils, ils n’aiment pas que l’on soit différent ni que l’on ne pense pas comme eux. Toi, tu es différent, plus doux et tes idées dans ta tête ne suivent pas le même chemin, alors ils ne peuvent pas comprendre. Aussi quand quelqu’un te traite de Fada, de simple d’esprit, t’insulte ou te dit quelque chose que tu ne comprends pas, souris, es ben mieil [c’est bien mieux].
- Mais je n’ai pas envie de sourire quand ils sont méchants !
- C’est pour cela qu’il faut sourire » m’a-t-elle répondu, s’ils voient qu’ils te mettent en colère, que leurs paroles te blessent, ils continueront et ce sera pire. Alors que, si tu leurs souris, s’ils te croient toujours content, ils se lasseront rapidement et te laisseront tranquille. Souvient-toi de cela et souris.
Ce fut quelquefois difficile, mais j’ai bien suivi son conseil, et comme il s’est révélé qu’elle avait raison, je suis devenu aux yeux des autres « Un Buon fada, tours counten », «le simple d’esprit au sourire » pour qu’ils me laissent en paix. » (p.28-29)
« Les animaux de travail une fois déchargés et les moutons parqués, intrigué par cet animal étrange je suis allée au parc des ânes. Ils étaient tous rassemblés dans le même angle du pré et Néan était seul de l’autre côté. Il semblait rejeté par les autres. Je me suis approché, il a tourné la tête vers moi, je lui ai tendu la main à plat comme mon père le fait avec les mules et il est venu la lécher . Sa langue était légèrement rappeuse. En écartant les poils qui me cachaient ses yeux j’ai découvert un regard si doux, si triste, que j’ai voulu le consoler. Je me suis approché tout près de lui et je lui ai parlé : « pourquoi es-tu si triste Monsieur l’âne ? Tu n’as pas de copains ? Les autres ne veulent pas de toi… ? C’est parce que tu n’es pas comme eux, même si tu es plus grand et plus fort. Tu veux être mon ami, dis ? »
Il m’a répondu d’un hochement de tête, je l’ai pris par le cou et il a posé sa tête sur mon épaule « on sera les deux Fadas, moi des hommes et toi des ânes mais personne ne doit le savoir, c’est notre secret ». (p.40-41)
« Et puis il y avait les regards. Tous ces regards des gens quand ils me voyaient : ceux qui surpris élargissaient leurs yeux en ouvrant la bouche comme des poissons morts, ceux qui me balayaient de la tête aux pieds avant de revenir sur mon visage, ceux qui se détournaient en une grimace ou dans un rire et ceux qui me transperçaient, comme si je n’existais pas. » (p.50)
« Elle a pris mon visage entre ses mains, appuyant son front sur le mien elle m’a dit : « il n’y a pas de mais… Jean-Noël, moi aussi les autres me disent différente. Ils m’appellent la Muette, parce que j’ai toujours été isolée, parce que je viens d’ailleurs, parce que Germaine n’a jamais voulu que je rencontre les enfants du village, que j’étais sale, mal vêtue, que je parle aux chiens, aux chèvres et aux fleurs et pas aux gens que je n’aime pas, qu’après la mort de Gabriel je n’avais plus envie de voir personne, je voulais juste être seule avec mes bêtes dans la montagne. Tu n’arrives pas à dire tout ce que tu ressens, mais moi je n’ai pas besoin que tu parles pour savoir, pour sentir comme toi la joie du lever de soleil qui réveille la peau, la sagesse d’un vieux mélèze, la peur des nuages d’orage qui t’arrivent dessus au galop tout chargés de foudre dans l’hostilité des rochers, le langage des animaux qui t’aiment, la colère devant l’injustice et la douleur causée par le mépris des autres. Tu comprends il n’y a pas de mais, car moi aussi je t’aime… je veux bien t’épouser, même si on n’a pas besoin d’être mariés pour s’aimer... ». (p.106)
« Nous avions peu parlé ensemble parce qu’il était comme ceux de la montagne, économe de paroles et de sentiments et que moi je parle beaucoup dans ma tête où les mots se mettent bien en place, chantent, dansent ou pleurent mais ils restent là. Je n’arrive pas à les dire, à les faire sortir, alors ils se bousculent comme un troupeau de moutons apeurés, ils se montent dessus, restent coincés dans ma gorge, ça me fait mal, ça m’énerve, aussi, le plus souvent je me tais. Maintenant avec mon père en moi, plus besoin de prononcer les mots et j’ai commencé à lui parler de tout. C’est venu petit à petit comme s’il était à mes côtés... » (p.121)
(Simple d’esprit. Le Fada de Bousieyas de Jean-Claude LEFEBVRE)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« J’avais une image de l’enfant qui, inachevé, pas encore arrivé, encore anonyme, se développait au milieu de nous.
J’avais l’image d’un être humain qui allait venir au monde, y grandir, le rendre meilleur d’une certaine manière. C’était une image typique. Typique dans ses particularités. Mon enfant, notre enfant, serait à sa hauteur, ça ne faisait aucun doute. Il lui correspondrait, il irait peut-être même au-delà de ses limites, il surpasserait l’image qu’on avait de lui. D’une manière ou d’une autre, ce serait le prolongement de ce que j’avais entamé, et avant moi, mes pères. Je portai cette image sous ma poitrine neuf mois durant, comme Kyôko l’enfant. » (p.116)
« La seule chose dont je me souvienne, c’est la gêne, vague brûlante, la gêne causée par un indifférent quand on m’a dit : Votre fils est handicapé. Il ne sera jamais comme les autres. Le sentiment, pas un sentiment : il y a confusion. Cet enfant n’est pas le mien, mais celui d’un autre. C’est une erreur, cet enfant-là, je le rejette. » (p.114)
« Il n’y a aucun doute. Nous l’avons constaté. Votre fils est handicapé. Une anomalie cardiaque de surcroît. Non, ça ne peut pas se corriger. Ça n’est pas le genre de chose qu’on corrige. Vous devez comprendre. Ce genre de chose demeure. Demeurera. On ne peut pas s’en débarrasser par une opération. (…) Il est important que vous le compreniez. Votre fils ne sera jamais comme les autres.
(…)
Lorsqu’il me demanda si j’étais prêt à le voir, à présent, je fis non de la tête et sortis sans dire au revoir. Je crois que j’avais peur qu’il puisse me ressembler. » (p.119)
« Je lui enviais la faculté qu’elle avait, contre toute raison, pensai-je, contre tout bon sens, de regarder cet enfant silencieux, silencieux, comme le nôtre, de l’accepter tel qu’il était, et de ne pas mentionner d’un seul mot sa déficience. Plus encore : de n’être consciente d’aucune déficience en lui. » (p.122)
« Aujourd’hui, je me dis : si j’étais resté assis, encore un moment, et si j’avais attendu qu’il me sourie. J’aurais découvert que son handicap était peu de chose par rapport au mien. Que ce qui était devenu dur en moi m’empêchait de senti, profondément et intimement, la tendresse de ses joues. De nous deux, c’est moi qui souffrais de la plus grande anomalie au cœur. » (p.123-124)
(La cravate de Milena Michiko FLASAR)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Ma vie me remontait à la gorge, m’étouffait de cette part sombre trop brutalement mise en lumière. Ce trou béant qui me torturait depuis si longtemps avait donc raison d’être ; j’étais un enfant adopté. Pire, un enfant regretté, méprisé au point que l’on n’avait jamais jugé utile de me dire ma propre vérité, quand tous les autres le savaient.
Au moins les multiples réflexions, les attitudes vexatoires, la discrimination que j’avais subies durant toutes ces années venaient-elles de trouver une explication. De même que l’amour fou porté par mes parents à une sœur sans âme, sans dignité et sans esprit mais fabriquée de leur chair et de leur sang. Une sœur qui leur ressemblait. Chaque détail, chaque événement revenait soudain habillé d’un sens neuf. Le peu d’intérêt de ma mère pour mes devoirs, mes amis, mes activités, alors qu’elle surveillait chacun des faits et gestes de Clélia. Ses affirmations définitives sur les garçons qui se fichaient forcément d’être bien habillés (je recyclais les vieilles chemises de mon père) et se trouvaient naturellement plus résistants que les filles pour lessiver le garage seul pendant que Clélia téléphonait à ses copines).
Et ces éternelles interrogations : de qui pouvais-je tenir mes yeux noirs ? Cette pilosité agressive ? Ma petite taille ?
- Ton arrière-grand-mère avait épousé un Grec.
- Un Grec ? Où l’avait-elle rencontré ?
- Qu’est-ce qu’on en sait. Tu nous fatigues avec tes questions.
Ceux qui avaient prétendu au rôle de parents m’avaient sciemment plongé dans l’obscurité. Était-il possible d’être si lâche et égoïste à la fois ? » (p.114-115)
(Providence de Valérie TONG CUONG)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« - Les autres jeunes, les profs, ils ne m’aimaient pas. Je n’avais pas ma place parmi eux.
- Écoute. » Danny a laissé tomber ce qu’il était en train de faire pour venir se planter à côté de moi.
(…)
Ton apparence ne compte pas, ma chérie. Peut-être que ces enfants se comportent d’une certaine manière mais il faut que tu leur laisses une chance. Mon plus jeune fils, Ben, a le syndrome de Down. Pourtant, il va à l’école et il a une tonne de copains. Alors ne laisse pas tomber, OK ? »
J’ai senti les larmes gonfler mes paupières et j’ai penché la tête pour qu’il ne les voie pas. Si Danny avait été mon père, les choses auraient été différentes.
« Tu vois, a-t-il poursuivi, le monde est grand et cet endroit est tout petit. Une petite ville, de petits esprits. Mais toi, tu peux être plus grande que ça. D’accord ? » Il a tapoté mon épaule avec sa grosse paluche, très gentiment. Je lui ai adressé un sourire à travers mes larmes et j’ai essuyé mes yeux avec la manche de mon pull. » (p.143-144)
« « Tu es parfaite, mon coeur. Tu es différente mais ça ne t’empêche pas d’être parfaite. Tu ne peux rien changer à ton apparence, ce n’est pas ta faute. Tu entends ce que je te dis, Rebecca ? Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? »
Elle m’a dit que j’avais quelque chose, un syndrome. Je lui ai demandé si on pouvait l’attraper comme un rhume, par exemple, et si ça partait quand on grandissait.
Elle m’a répondu tristement : « Non. Non, mon coeur, je suis désolée. » Elle m’a dit que ça s’appelait Treacher Collins. Elle m’a expliqué que les os de mon visage ne s’étaient pas formés comme il le fallait quand j’étais dans le ventre de ma mère et que c’était la raison pour laquelle mon visage était un peu différent.
(…)
Même si elle m’avait expliqué ce qui n’allait pas, même si elle avait donné un nom à cette chose, même si elle m’avait dit que je n’étais pas la seule à devoir endurer cela, Les Parents avaient déjà décidé depuis longtemps de mon sort et je portais leur dégoût de moi comme une marque au fer rouge. » (p.206-207)
(Des bleus au coeur de Louisa REID)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« J’étais loin d’imaginer que Charles m’avait choisie sur des critères méticuleusement inscrits dans l’un de ses cahiers. Je faisais partie du plan. Mon physique, la blondeur, les yeux clairs, mon tempérament, discipliné et malléable, mon incapacité à me rebeller : j’étais précisément celle qu’il cherchait, la mère de famille lisse et sans surprise, ornant à la perfection un tableau familial qui ferait rêver ses électeurs – il me l’a même jeté à la figure, quelques années plus tard.
Aujourd’hui encore, j’ignorais quel type de sentiments il éprouvait réellement à mon égard, et même s’il avait été ou était réellement capable de sentiments. Je crois que le simple fait d’avoir atteint son objectif - en l’occurrence, me posséder, ou plutôt me détenir – lui procurait une immense satisfaction, une jouissance même, qu’il renouvelait par jeu à intervalles réguliers, me blessant, m’amenant jusqu’au point de rupture, puis me rattrapant et s’excusant, déployant déclarations enflammées et engagements rarement tenus.
L’amoureux s’était progressivement transformé en dictateur, mais qui pouvait s’en douter ? Il était si bon comédien.
Mes parents l’adoraient. Il faisait parfaitement illusion en gendre idéal, dévoué, exemplaire, offrant généreusement voyages et cadeaux luxueux, travaillant sans compter tout en protégeant son clan.» (p.58)
« Tu es mon cancer, ai-je pensé. Tu as semé tes métastases avec adresse, tu m'as affaiblie d'année en année, mais Dieu sait comment, j'ai réchappé de tes attaques insidieuses, répétées, et aujourd'hui, quelque chose d'inespéré se produit, tu ne m'atteins plus, comme le prévoyait Jean, j'ai ôté ces lunettes que tu m'avais imposées, je vois le monde par moi-même, je te vois tel que tu es, un homme sans compassion, un type dévoré par l'ambition personnelle, un sale con qui m'a utilisée de toutes les manières possibles, mais qui n'a jamais aimé personne d'autre que lui-même. » (p.134)
« Car il est là le malentendu. Comme une femme battue qui pardonne encore et encore, j’ai voulu croire toutes ces années que tu éprouvais pour moi des sentiments profonds. J’ai voulu croire que tu changerais. Quoi qu’en dise Jean, tu ne m’aimes pas mal, tu ne m’aimes pas. Je compte pour toi, oui, parce qu’un député de la droite très catholique se doit de présenter une famille rassurante. Je compte pour toi parce que j’élève tes enfants. Je compte pour toi tant que je suis exactement celle que tu veux au millimètre près. Je compte pour toi comme une décoration au revers de ton costume. » (p.142)
(L’atelier des miracles de Valérie TUONG CONG)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Dans quelle société se sent-on habilité à penser que les femmes sont là pour le plaisir du regard des hommes ? »
« Le truc, c'est que tout notre environnement médiatique incite à regarder et à jauger des corps de femmes. Il en est saturé.
Que ce soit au cinéma, dans la pub, l'univers de la BD, ou les jeux vidéo.
Dans ces univers, les femmes sont non seulement représentées de manière hypersexualisée, mais en plus, bien souvent, elles n'ont ni rôle, ni dialogue, parfois même pas de prénom. En gros, elles sont juste là pour servir de caution 'nichons' »
« Déjà, les spectateurs de genre et orientation sexuelle oubliés doivent s’adapter, soit en s’imaginant dans des rôles de peu de valeur, soit en renonçant à leur identité pour s’imaginer mâles et hétéros.
Or nous nous construisons dès tout petits par les personnages auxquels nous nous identifions. C’est du coup problématique d’avoir à choisir entre la potiche et la norme du mec hétéro, si ce n’est pas notre identité. »
« Eh bien les chercheur-euse-s ont constaté que si nous regardons bien les hommes comme des êtres humains, les femmes en revanche étaient analysées de la même façon que des objets, et ce, quel que soit le genre de la personne qui les regarde »
« Or, si on interagit avec une personne, à l'inverse, on se sert d'un objet. Et voir les femmes comme des objets pose des problèmes évidents de respect de leur consentement... »
(Un autre regard d’EMMA)
https://emmaclit.com/
 votre commentaire
votre commentaire
-
« - Je ne comprends pas. Pourquoi on m'aurait fait ça ? Sans jamais m'en parler ? A quoi ça sert ?
- A rien, malheureusement. C'est une tradition ancestrale, coriace. J'imagine que, pour vos parents, la pratiquer devait relever de l'évidence. Qu'autour d'eux, toutes les femmes, depuis des générations…
- Mais c'est délirant…
Awa secouait la tête, furieuse :
- ...que personne n'ait pensé à m'avertir qu'on avait coupé une partie de moi, POUR RIEN. » (p.30)
« ...je sais, vous allez dire que je suis très soutenue. Mais moi j'ai l'impression d'avoir été court-circuitée, vous comprenez ? On avait décidé pour moi, ensuite on a résolu le truc sans moi. Tout a changé, et finalement rien n'a changé : on n'en parle plus. Cette fois-ci, je veux comprendre : ce qui se passe dans ma famille ; qui a pris les décisions ; qui a su, pourquoi ils ont voulu ou accepté qu'on nous mutile, comme vous dites. » (p.34)
« - Je n'ai rien pris, annonça Awa d'une voix claire. J'aurais eu l'impression de tricher si je l'avais fait.
Si je dois vivre avec une coupure en moi, je veux la ressentir, je veux l'intégrer, je veux… comment dire… je veux l'éprouver.
L'endormir avec des médicaments, ce serait comme l'escamoter, comme prétendre que tout va bien en supprimant la sensation. Finalement, ça conforterait ce que vous venez de dénoncer : l'idée d'un sexe honteux. Je ne veux pas oublier mon sexe et la douleur qu'il renferme. Ce serait prolonger l'amputation. » (p.65)
« Une opération, c'est une intervention sur le corps qui sert à faire du bien, à soigner. Une mutilation, c'est quand on abîme intentionnellement quelqu'un. On le blesse, on lui fait prendre des risques, parfois on le tue, et tout ça sans aucune raison médicale. Tu imagines ? Cent trente millions de filles à qui on a fait mal parce que c'étaient des filles. Par pure discrimination. » (p.80-81)
« J’ai appris que j’étais excisée, qu’on avait enlevé une partie de mon sexe quand j’étais petite. Une coupure tellement douloureuse que je commence tout juste à en avoir quelques souvenirs, qui sont horribles, séquentiels, comme des flashs. J’ai rencontré une militante qui anime des groupes de parole : elle m’a dit que la société inflige ça aux femmes pour les contrôler. Elle fait le parallèle avec le bandage des pieds des Chinoises, jusqu’au siècle dernier : focaliser les femmes sur leur souffrance, régir leurs mouvements ou leur ôter toute possibilité de plaisir, les inféoder à leur rôle de matrice maternelle. » (p.101)
« La psychologue, quand j’ai eu fini de tout parler, elle m’a expliqué ce qui t’était arrivé. Moi, j’étais prête pour la sensibilisation, j’étais d’accord pour l’accompagnement, le suivi, j’étais d’accord pour tout à condition que l’histoire ne se répète pas. C’est ça que je voulais te raconter : que c’est avec toi que j’ai appris. Je voulais que tu saches pourquoi toi et pas les autres. Que tu ne croies pas que je t’aimais moins. Que tu comprennes que j’étais ignorante avant que tu m’ouvres les yeux, avec ta tristesse et tes mouvements de recul dès qu’on t’approchait. » (p.227)
(La tête ne sert pas qu’à retenir les cheveux de Pauline PENOT et Sabine PANET)
 votre commentaire
votre commentaire
-
« J’étais évidemment beaucoup moins préoccupée que maman par ce handicap, mais je supportais très mal la façon dont les gens regardaient Ben. Ils l’observaient d’une manière appuyée, le regard horrifié, le visage figé, en détournant ensuite la tête comme s’ils n’avaient rien remarqué. Mais dès que j’avais le dos tourné, pour chercher un pot de confiture ou autre, je sentais leurs yeux fixés sur le pauvre petit Ben. Il est vrai qu’il s’en moquait, lui, tout occupé à attraper ses pieds pour se les fourrer dans la bouche, comme le font tous les bébés. Seulement voilà, ben avait deux ans. Avant de l’emmener faire des courses, je me sentais comme un gladiateur romain qui se ceint les reins pour affronter son adversaire. J’évitais la rue principale, je me dirigeais vers le boulevard le plus éloigné de l’école pour me donner l’illusion d’être à l’abri des regards. Mieux, je prenais les devants, prête à fustiger les mal-appris, ne fût-ce que symboliquement. Et je suis sûre que je souffrais plus que maman lors de ces expéditions. Les gens n’osaient rien lui dire, à elle. Mais comme je paraissais très jeune – on me donnait treize ans à peine alors que j’avais quatorze ans et demi – ils prenaient avec moi toutes sortes de libertés. Un jour, une femme m’a arrêtée en disant :
- Vous permettez, mon, petit ?
Et puis elle s’est penchée sur Ben en écarquillant les yeux, et a ajouté :
- Qu’est-ce qu’il fait là, celui-là ? Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi vilain.
Enfin elle m’a lancé un drôle de regard, comme si elle pensait que j’étais folle ou quelque chose comme ça. Les enfants me gênaient beaucoup moins. Ils disaient tout haut ce qu’ils pensaient, sans dissimuler leur curiosité, comme : « Regarde, maman ! Il a une drôle de tête, le bébé !» Mais je ne supportais pas les mères qui disaient « Chut ! » en entraînant leur progéniture. Pourquoi ne souriaient-elles pas et ne disaient-elles pas quelque chose de gentil comme : «Oui mais il a de jolis cheveux bouclés », ce qui était la vérité. » (p.38-39)
« -Dis donc… Elles ne sont pas au courant, tes copines, pour Ben ?
J’ai secoué la tête.
- Elles ne l’étaient pas ; eh bien, elles ne vont pas tarder à l’être.
Mme Chapman m’a donné une petite tape.
- Bien ! tu dois m’en vouloir assez d’avoir vendu la mèche, mais tu vois, je ne te ferai pas d’excuses. Tu es un peu sotte, Anna. Tu ne peux pas garder une pareille chose secrète. Il est grand temps que tes copines sachent la vérité. Tu n’as pas honte de Benny, au moins ?
- Bien sûr que non, dis-je, tout en sachant bien que je mentais. » (p.42-43)
« - De quoi as-tu peur, alors ? dit-elle. De leur compassion ? Ne sois pas stupide, Anna. Nous avons tous besoin de compassion. Il faut seulement que tu apprennes à l’accepter. Il est quelquefois plus difficile d’être celui qui reçoit que celui qui donne. » (p.44)
(Mon drôle de petit frère d’Elizabeth LAIRD)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
"Les bibliothèques sont des conserves de savoir"